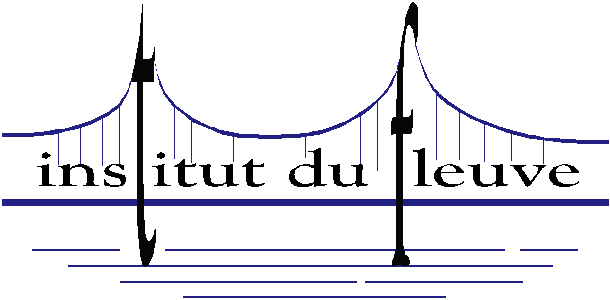Résumé
 Paquebot Laos |
En 1962, Jean-Claude Didelot, alors Eléve Officier au Long Cours à bord du paquebot « Laos » des Messageries Maritimes, avait participé au sauvetage de deux jeunes passagers clandestins vietnamiens. Cet épisode l’avait sensibilisé au drame vécu par cette région du monde et c’est tout naturellement qu’en 1964, durant son service militaire comme officier de Marine, il répond à une demande de parrainage émanant de l’Association pour la Protection de l’Enfance du Laos. Il devient l’un des premiers parrains de l’association. Dés lors, une correspondance s’établit avec René Péchard et il consacre ses congés à l’aide de cette petite association laotienne. |
En 1968, rencontre avec René Péchard à l’occasion de son premier séjour en France depuis 23 ans. A l’issue de ce voyage, Jean-Claude Didelot, alors âgé de vingt-sept ans, fonde à Paris « l’Association pour la Protection de l’Enfance du Laos – France » et ouvre le premier foyer à Fourmies. Il quitte la navigation au Long Cours, se marie, entre dans le groupe Hachette. Il y sera successivement délégué pédagogique, directeur régional, directeur commercial, directeur du développement avant de fonder en 1979 les éditions du Sarment – Fayard puis, en 2001 les éditions du Jubilé.
 Premier conseil administration |
 Premier foyer en France |
 Départ de mission en France |
 JCD et RP à Orly 1968 |
Dés lors, épaulées par de nombreuses et discrètes générosités, les deux associations coopèrent étroitement. Distinctes au plan juridique, elles ne forment en réalité qu’une seule œuvre dont le cœur est René Péchard.
En France, les jeunes sont accueillis soit définitivement (mineurs isolés), soit le temps de terminer leurs études. Des foyers sont ouverts à Fourmies, Rouen, Saint Brieuc. Sept cent un enfants auront été accueillis par les soins de l’association entre 1963 et 1975. L’association est alors reconnue comme œuvre d’adoption.
Un réseau de délégués couvre progressivement l’ensemble des régions. Des rencontres nationales annuelles où les asiatiques ont la première place, soudent des liens sans que les raisons du cœur ne soient jamais inféodées à la religion, l’argent ou la politique.
Tout cela est réalisé au prix d’un énorme travail. L’association ne dispose d’aucun salarié. Le bénévolat est la règle. Le premier bureau est hébergé au domicile de Jean-Claude Didelot.
| Documentation | Audio | Photographies |
Extraits de « Piété Filiale »
Jean-Claude Didelot : « En cette année 1968, Orly accueillait encore les avions en provenance de Thaïlande. Le Laos ne bénéficiait pas d’une liaison directe. D’ailleurs, ce pays, l’un des plus pauvres de la planète, était largement ignoré des Français… Moi-même, je n’y étais jamais allé et je n’avais encore jamais rencontré l’homme que j’attendais ce jour-là. Je ne savais pas la place qu’allaient prendre, dans ma vie et dans celle de beaucoup, ce pays lointain et ce correspondant encore sans visage. René Péchard apparut, mêlé aux autres passagers; silhouette massive, économe de ses mouvements, avare de paroles, pudique dans ses sentiments, comme ramassé autour de la mission qu’il s’était donnée et qui l’occupait tout entier. Il m’avait demandé de l’accueillir seul et, me prenant à part dans un coin de la salle d’attente, cet homme de cinquante-six ans s’ouvrit humblement, au jeune homme de trente ans son cadet, de toute une vie de peines et de combats : il voulait s’assurer que mon adhésion reposerait sur une connaissance exacte du passé et que les risques que je prendrais en m’associant à son œuvre seraient assumés en toute connaissance de cause.
L’expérience de la vie me faisait encore défaut, mais je ressentis confusément que l’humanité profonde qu’il dégageait était fondée, par-delà les épreuves – et sans doute grâce à elles – sur une foi qui la transcendait.. Sans que je le cherche, les événements me montreraient que rien de ce qu’il me confia ce jour là n’avait été inexact ou gauchi à son profit et lorsque, bien des années plus tard, les calomnies enflant, je serais amené à lui demander, non que j’en eusse besoin pour moi, mais pour le défendre, des preuves de ce qu’il avançait, ces preuves le confirmeraient jusque dans les détails. Certes, il conservait ce jardin secret auquel chaque homme a droit, et qu’il a le devoir de préserver lorsque d’autres – en particulier appartenant au cercle familial – sont concernés, mais il assumait tout de sa vie avec ses ombres et ses lumières. Ces ombres étaient plus des erreurs que des fautes et ses lumières étaient enrobées de pudeur. Détenteur d’innombrables secrets que son destin hors du commun lui avait fait rencontrer, confident de bien des misères, il pratiquait à l’extrême la si rare vertu de discrétion. Je ne l’ai jamais entendu s’exprimer sans nécessité. Il devait me laisser après sa mort le double de quelques correspondances ou documents destinés à rétablir la vérité en cas de besoin et je m’apercevrai ainsi qu’il avait été amené à intervenir sans bruit – jamais pour se défendre – toujours pour défendre son œuvre, c’est-à-dire les plus démunis, contre la malveillance. Ces documents, et d’autres, sont aujourd’hui confiés à des anciens de confiance, qui, si nécessaire, en feront l’usage que leur dicteront leur conscience en fonction des circonstances..
J’étais jeune, sans charges familiales autres que ce petit Phuc, arrivé quelques mois auparavant sans crier gare et dont il fallait se préoccuper : il m’était facile de prolonger mes congés par une période d’une année sans solde, et, sans plus lui poser de question, je me mis à sa disposition. Je ne devais jamais le regretter. Il ne perdit pas de temps à épiloguer sur notre correspondance passée, ni même sur la tâche à poursuivre et nous prîmes la route sans plus tarder après un passage à la Préfecture de Police. Le chef du service des interdictions de séjour, ayant pris connaissance de la lettre que l’ambassadeur de France au Laos lui avait remise, se leva et tint à le raccompagner jusqu’à la porte…Un matin, dans un hôtel de province, la gendarmerie se présenta pour une vérification d’identité. Il était en règle mais je souffris avec lui des regards du patron.
Levé dés quatre heures du matin, il préparait soigneusement chaque étape. Nous roulions sans désemparer. C’est une France insoupçonnée qui se révéla. En quelques années, l’«Association pour la protection de l’enfance du Laos » avait tissé un véritable réseau de solidarité, et ce réseau se superposait au pays gavé, matérialiste et pas encore touché par le chômage que je croyais connaître. Nous arrivions dans quelque village éloigné. Sur la place, un enfant bronzé aux cheveux noirs et raides jouait parmi ses camarades bourguignons ou bretons. Il s’arrêtait pile dans sa course : « Tonton ! ».
La fin de cet été 1968 approchait et avec elle, celle de la vaste tournée qu’il avait entreprise pour retrouver tous « ses » enfants, mieux connaître les familles d’accueil, remettre à chacun un souvenir, un mot, parfois une cassette enregistrée, souvenirs très chers du lointain Laos. A l’issue des visites, tandis que nous reprenions notre route, René Péchard me racontait l’histoire du jeune que nous venions de rencontrer. En contrepoint de l’histoire officielle, celle qu’exposaient les journaux et qui était tissée de batailles, de discours et de traités, surgissait la vie d’un peuple qui tentait seulement de survivre. Bien rares étaient ceux qui, volontairement, avaient voulu partager son sort en essayant simplement de soulager ses détresses. Je les découvrais avec admiration, personnes souvent modestes, inconnues, qui depuis des années aidaient dans l’ombre et l’abnégation cette petite « Association pour la Protection de l’Enfance du Laos », perdue au bout du monde. J’apprenais aussi à mieux connaître celui qui avait su susciter toutes ces bonnes volontés.
Il fallait prévoir l’avenir, anticiper l’arrivée probable du communisme au Laos et c’est ainsi que nous fondâmes ensemble à Paris une association portant le même nom que celle de Vientiane. J’en étais et en resterai le vice-président, mais l’âme en est et en sera pour toujours celui que nous appelions avec une respectueuse affection : « Tonton ». Je n’avais jamais voulu être président de l’association française, pour lui réserver cette fonction en cas de besoin et c’est d’ailleurs ce qui arriva lorsque quelques années plus tard, l’association de Vientiane sera accaparée par les éléments hostiles qui la détruiront.
Je sorti alors du chenal balisé où je m’étais engagé pour une autre traversée à bord d’un rafiot sans premières classes, aux entreponts encombrés de passagers sans visa. A bord de ce bateau là, on y prenait « soin » en dehors des quarts. Alors, Celui qui échappe à nos jumelles et à nos équations se révéla à portée d’amour dans le visage des pauvres. Quant au bonheur… il y a la vie éternelle pour cela. Un jour, que rapproche chaque tour d’hélice, ce sera aussi pour moi « terminé pour la machine » et je poserai mon sac. Je retrouverai René Péchard qui m’a fait passer de la première classe à l’entrepont
…………….……
René Péchard : « En1968, nous avons fondé en France une association sœur de celle du Laos. Très régulièrement, désormais, je reviendrai en métropole pour des voyages d’un mois. Contrairement à ce que l’on a pu raconter, je n’ai rien fondé tout seul. S’il n’y avait eu Jean-Claude Didelot, par exemple, et beaucoup d’autres personnes de bonne volonté, jamais l’association française n’aurait pu voir le jour…
Au cours de ma première tournée dans l’Hexagone, il y eut d’abord la création des premières délégations. Ces groupements furent tout d’abord animés par des familles qui avaient accueilli des enfants ou par des bienfaiteurs qui, depuis 1958, nous avaient prêté main-forte. Encore aujourd’hui, des délégués de la première heure continuent à « faire le coup de feu »…
Je sais que cela peut paraître une redite, mais je tiens, oui, je tiens, du fond de mon cœur de «tonton », à remercier ceux qui se sont dévoués auprès de Jean-Claude Didelot pour constituer le premier conseil d’administration. Ma mémoire est un peu défaillante : je ne peux les nommer tous, mais je voudrais évoquer ici le souvenir de M. Bellière, notre cher président du début. Il nous a quittés pour Dieu en 1984. Et puis Mlle Cadiergue qui lui a succédé, et Michel Leclerc qui a pris la relève avec tant de dévouement… En 1975, quand le Laos s’est fermé, je suis revenu en France et Michel m’a passé le flambeau.
Mais c’est à Jean-Claude Didelot que va ma particulière reconnaissance. En effet, si, pour des raisons diverses, différents présidents se sont succédé à la tête des « Enfants du Mékong », Jean-Claude est resté dès les premiers jours le vice-président, c’est-à-dire la cheville ouvrière de l’Association, et il n’a jamais un seul jour hésité à dispenser son aide. Depuis mon retour en 1975, j’ai trouvé en lui un collaborateur efficace et discret. »
Jean-Claude Didelot : « … Et moi, qui avais déjà, selon la chair, un père qui comblait les désirs de mon cœur, j’ai trouvé en René Péchard un autre père. Le premier s’était toujours trouvé du bon côté, et sa vie s’était déroulée toute droite. Le second avait toujours partagé le sort des vaincus et sa vie avait été un perpétuel recommencement. C’est ainsi que ma vie, pourtant issue d’un milieu et d’une histoire tellement différents, rejoignit la sienne en 1968. J’étais alors, comme beaucoup de jeunes gens de mon âge, de mon milieu social et de mon éducation, bardé de certitudes où religion, convictions et conditionnements se mêlaient. Le parcours parfois douloureux sur lequel je m’engageai à sa suite, en me dépouillant du confortable partage entre les bons (où nous nous situons volontiers) et les mauvais (les autres !), me conduirait à considérer les fruits plus qu’à m’en remettre aux incantations vertueuses. Cette double filiation m’ouvrit à une paternité renouvelée dans une relecture renouvelée d’un Evangile dont j’avais occulté des pans entiers. A l’image du Seigneur qui alla jusqu’à se laisser trahir par Pierre, René Péchard donnait à ceux qui le rencontraient la chance de se reprendre. D’aucuns auraient pu voir de la naïveté là où il n’y avait qu’un appel ».
René Péchard : « En 1967, le gouvernement français m’avait fait cadeau du premier coopérant catholique. Il est resté deux ans, comme tous les jeunes qui, sans être militaires, font leur service national dans une œuvre ou dans un service public. Tous les deux ans, nous en avons vu arriver : un, puis deux, puis trois, puis quatre, envoyés pour la plupart par des organismes catholiques, via le ministère de la Coopération. J’ai perdu le contact avec le premier d’entre eux. Pour ce qui est des autres, je suis resté en relation avec le père Baudry, qui assume ou a assumé la responsabilité du grand séminaire de Nantes, et le père Joël, prêtre chez les prémontrés, à l’abbaye de Mondaye. C’est là, grâce à lui, que nous avons organisé la première rencontre de l’Association. Il y a aussi Jean Peronnot, qui a été ordonné en 1985 dans la Compagnie de Jésus. Pour ce qui concerne les autres, l’un est contrôleur des chemins de fer; quant au dernier, je sais qu’il jouit d’une situation tout à fait satisfaisante…
Jean-Claude Didelot. « Beaucoup plus tard, on déniera à René Péchard la fondation des volontaires français qu’on appellera « Bambous », tout comme on prétendra qu’il n’a jamais pu entrer dans les camps de réfugiés. Contre vérités dont font litière de très nombreux documents… Il omet volontairement de citer le premier coopérant à qui il avait confié la direction de l’association durant son séjour en France. Trente cinq ans plus tard, il faut bien en revenir à cette pitoyable entreprise qui appellerait silence et oubli si elle ne portait en germe des constantes telle l’étonnante propension de prédateurs de passage à s’approprier pour les transformer en champs de ruines ce que d’autres avaient patiemment bâti sans eux…
Un ami l’avait prévenu le soir même de son retour à Vientiane : le conseil d’administration avait été convoqué secrètement pour le lendemain. A l’ordre du jour, l’éviction du fondateur (cinquante-six ans dont vingt-deux ans d’Indochine), son remplacement par N… (vingt deux ans dont trois mois au Laos), le renvoi de la moitié des jeunes, la fermeture de certains foyers, l’abandon des projets d’expansion.
Le jeune directeur a profité de l’absence de René Péchard pour faire campagne. Fermé à la différence, étranger aux détresses, tourmenté par quelque refoulement, jaloux de l’affection des jeunes, incapable de créer, soucieux de reconnaissance sociale, il prend prétexte de rencontres, le plus souvent bien platoniques, entre garçons du foyer et jeunes filles. Il s’ouvre de ses émois auprès d’oreilles complaisantes et, se drapant de vertu, prétend se substituer au président légitime : ainsi le prendra-t-il de vitesse avant d’avoir à rendre des comptes et travestira-t-il sa trahison en croisade. Il a instruit le procès en l’absence de l’accusé : René Péchard a enfreint les statuts en acceptant des enfants d’origine vietnamienne ou chinoise ! Il a accueilli des jeunes de la rue qui nuisent à notre réputation ! Il va jusqu’à les traiter comme ses propres enfants! Ce n’est pas un président, c’est un père ! C’est donc qu’il a besoin d’eux ! Il compromet nos finances ! Il discrédite l’association qu’il a fondée ! Il est imprudent ! Le temps du pionnier est passé ! Qu’il démissionne et se taise ! Ce discours est bien reçu par certains notables xénophobes qui y voient l’occasion de se parer à bon compte d’un vernis humanitaire, voire de se partager quelques prébendes sous couvert de morale et – pourquoi pas ? – de religion. Une morale qui jette des enfants à la rue, une religion qui exclut les pauvres.
……………………………………………………..
Dominant sa fatigue, délaissant provisoirement les multiples appels à l’aide qui l’assaillent, René Péchard, épaulé par l’affection et la détermination des jeunes des foyers, parvient à préserver son œuvre. La crise est surmontée. Elle aurait pu se terminer très mal pour le pauvre traître qui, s’il avait réussi, aurait traîné cette tache sa vie durant. « Tonton » a appris d’une vie blessée la spirale infernale qui peut conduire un brave garçon peu structuré, aux pires extrémités, pour peu qu’il tombe aux mains des idéologues, médiocres ou simplement pauvres types. Il pardonne le tort irréparable infligé par des soupçons habilement distillés. Quant au mal fait aux « poussières de vie[1] », le pardon appartient à un Autre: « J’étais un gosse de la rue et tu m’as renvoyé… ».
Pour l’heure, coupant court aux susceptibilités ethniques, l’Association devient Association pour la Protection de l’Enfance au Laos. Nous empruntons, multiplions les appels en France, ouvrons de nouveaux foyers au Laos.*
René Péchard : « Jusqu’alors, les jeunes qui venaient en métropole devaient impérativement être accueillis par des familles, puisque l’Association n’avait pas d’infrastructures en France. En septembre 1968, nous avions décidé d’envoyer en métropole des garçons plus grands ou plus âgés, pour qui l’accueil familial était plus difficile. A cette époque, les familles amies étaient un peu réticentes pour accueillir des adolescents. Il était pourtant important que cela puisse se faire, que l’on montre que c’était possible. Il fut donc décidé de recevoir des jeunes dans un internat, en leur assurant un foyer, un chez-eux pour les week-ends! Les familles qui tentaient l’aventure le faisaient en ayant la sécurité que, en cas de difficulté majeure ou d’échec, l’Association assurerait la relève. Une douzaine de jeunes en provenance de Vientiane, âgés de quinze à dix-huit ans, furent accueillis dans le Nord à l’institution Saint Pierre de Fourmies. L’arrivée des garçons en France n’a manqué ni de sel ni de péripéties. En attendant la rentrée des classes, un accueil aussi chaleureux, aussi familial que possible, fut improvisé chez une amie fidèle de l’Association. Comment oublier le dépaysement, les surprises, l’étonnement de ces jeunes brusquement transplantés de leur pays natal en France ? On ignorait à cette époque-là que ces garçons n’étaient que l’avant-garde du déferlement immense des réfugiés qui allait, quelques années plus tard, frapper aux portes de notre pays. L’Association existait légalement en France et les bonnes volontés étaient nombreuses. Mais beaucoup de choses restaient à faire. Les locaux, en particulier, manquaient. Après plusieurs pérégrinations à Paris, hébergée de bric et de broc dans des pièces prêtées par des amis, l’Association put finalement bénéficier d’un local à elle, prêté par l’Union nationale des anciens combattants, rue de Vézelay, et cela grâce à l’aide de Mme Bastid, présidente des Anciens d’Indochine. Mme Bastid, dès cet instant, n’a cessé de manifester sa bienveillance à l’association. »
Jean-Claude Didelot : « Il avait bien fallu quelqu’un pour recevoir la douzaine de jeunes dont parle René Péchard, maintenir le lien avec les familles d’accueil, les relayer en cas de difficultés, s’assurer des scolarités. C’est ainsi que pour m’y consacrer, je quittai définitivement la navigation au Long Cours. Ce fut un arrachement. Ce sera une grâce. Ma vie bascula. J’entrai un peu par hasard dans le groupe Hachette où je serai successivement délégué pédagogique, directeur régional, directeur commercial, directeur du développement avant de fonder en 1979 les éditions du Sarment et en 2001 les éditions du Jubilé.
Alors, les événements s’accélérèrent. René Péchard pressentait le cours qu’ils allaient prendre dans les trois pays de l’ancienne Indochine. Il avait été prisonnier du Viêt-minh durant trop d’années pour se faire des illusions sur les intentions réelles du Viêt-cong, des Khmers rouges et du Pathet Lao que les médias présentaient à l’envi comme de simples mouvements nationalistes. L’avenir des jeunes eurasiens ne pouvait être imaginé qu’en France. Les Laotiens ou les Vietnamiens du Laos les plus doués, auraient à participer à la reconstruction de leur pays. Les possibilités d’études supérieures y étaient inexistantes. Pour eux aussi, il fallait envisager une expatriation, provisoire celle-là. La France des années soixante-dix était riche, ouverte, pas encore xénophobe, mais déjà atteinte par la dérive des esprits. Les jeunes Asiatiques trouvèrent donc assez facilement l’accueil matériel dont ils avaient besoin, de l’amitié, du travail, mais furent trop souvent profondément atteints dans leur intégrité et leur dignité par une société tellement différente de celle, traditionnelle, qu’ils avaient connue. La plupart accusaient un retard scolaire par rapport aux normes françaises. L’enseignement catholique sut faire preuve de la souplesse et de la générosité nécessaires pour les accueillir. Pourtant, là aussi sévissait une crise d’identité qui en désorienta un grand nombre. Ces enfants de culture bouddhiste attendaient un environnement spirituel qui fit parfois défaut.
L’arrivée des premiers jeunes en provenance de Vientiane fut en effet pittoresque. Nous n’avions rien pour les loger en attendant la rentrée des classes et l’ouverture du premier foyer. Il fallut utiliser deux grandes tentes de l’armée plantée dans un parc de la région Parisienne. Nous déjeunions sur des planches posées sur des tréteaux. Il suffisait d’un mot de tonton pour rétablir immédiatement l’ordre en cas de besoin. Il glissait à mi-voix à son voisin : « Dites à Kha (ou à Thien ou à Ly…d’arrêter de faire l’idiot… » et le silence se faisait au rythme de la progression du message qui atteignait enfin son destinataire et nous avions droit à un sourire contrit parfois embué si grande était l’autorité naturelle faite de respectueuse affection et certes pas d’une quelconque prégnance- qu’il avait acquise auprès de ses enfants.
A l’image de la plupart des Français, j’aurai volontiers passé à d’autres la charge : « Il y a des organisations, des bureaux, des commissions… ». Oui, bien sûr, tout cela existait, mais il fallait s’inscrire dans un cadre administratif précis et ces oubliés de la guerre d’Indochine n’y entraient pas. Ce serait d’ailleurs un de nos soucis que de leur faire reconnaître leurs droits, de rétablir des états civils, d’obtenir des prises en charge qui ne soient pas des prises de pouvoir.
Un enfant eurasien arriva dont l’acte de naissance portait la mention : « Né de père et de mère inconnus. » La famille qui l’avait recueilli se présente au bureau compétent en vue d’obtenir la modeste allocation à laquelle il pouvait prétendre :
« Hélas! leur dit le fonctionnaire, le cas n’est pas prévu! Il faudrait qu’il soit orphelin de père ou de mère, ou orphelin de père et de mère, ou encore né de père ou de mère inconnu… mais né de père et de mère inconnus, non! »
Renseignements pris, il fallait une modification de la loi elle-même.
Tant bien que mal, et sans doute plus mal que bien, il me fallut essayer de faire face, tandis que René Péchard repartait pour Vientiane. La correspondance reprit. Par courrier, il continuait de suivre discrètement « ses » enfants qu’il avait élevés, qu’il aimait et que, délibérément, pour leur bien, il avait confiés à d’autres. Lorsqu’il revint en France l’année suivante, en 1969, je venais de me marier et j’avais une autre bonne raison pour passer le relais :
« J’ai beaucoup d’affection pour ces jeunes Asiatiques, mais je sens qu’il y a une part de leur personnalité que je ne saisirai jamais vraiment. Je préfère m’en tenir à une aide administrative. »
La réponse était différente de ce qu’on pouvait attendre. Elle devait me lier pour longtemps :
« Maintenant que vous avez compris cela, vous pouvez continuer! »
Dés lors, les jeunes se mirent à m’appeler moi aussi, « Oncle » voire « Tonton »…Peu à peu, je m’imprégnais d’une réalité que j’avais ignorée jusqu’alors et apprenais à reconnaître cette blessure de paternité caractéristique de notre temps et qui touche autant les pères que les enfants. Menant de front la direction régionale Nord d’Hachette, et l’animation de l’Association, j’ouvris nos premiers foyers à Fourmies, Saint Brieuc et Rouen. Il fallait en assurer le suivi, trouver des fonds, visiter les familles d’accueil. Les jeunes qui y furent accueillis sont aujourd’hui pères et mère de famille et parfois grand-parents. Beaucoup sont restés fidèles. Constamment en déplacements, je consacrai la journée à mon travail professionnel, et les soirées à l’Association. Ce n’était pas toujours facile.
Un club de notables m’invita à prendre la parole dans une petite ville de province. Je me levai à l’issue d’un dîner qui avait quelque peu échauffé les esprits et commençai en rappelant que la France avait longtemps été présente au Laos et qu’il ne fallait pas s’étonner que les militaires en partant y aient laissé des enfants. Un convive m’interrompit violemment :
« Je vous interdis d’insulter l’armée Française ! »
Décontenancé, je tentai de lui expliquer que descendant de trois générations d’officiers, ancien élève du Prytanée militaire de la Flèche, officier de marine de réserve, je n’en avais nullement l’intention. Le président du club me donna le fin mot de l’histoire : ce monsieur était un ancien d’Indochine et avait fait confidence à quelques-uns de la femme et des enfants qu’il y avait laissés. Rentré en France, sa famille avait refusé d’en entendre parler… Sans le vouloir, j’avais touché une plaie ouverte. L’honneur de l’armée française était un prétexte…
Un jeune sous-lieutenant vivait en ménage avec une jeune femme laotienne qui lui avait donné une petite fille. Il fut tué en opérations avant d’avoir pu régulariser sa situation. René Péchard cru bon d’écrire à sa mère, lui disant que dans son malheur, il lui restait une consolation : elle était grand-mère d’une petite Loan qui portait son nom. Il reçut une réponse courroucée qui aurait prêté à sourire en d’autres circonstances :
« … Mon fils était incapable de faire une chose pareille. Qu’on ne m’en parle plus jamais ! »
Je ne sais ce que sont devenues cette vieille dame et cette petite fille qui auraient pu unir leurs solitudes. Ce refus d’accepter la vérité, ce corsetage moral plus souvent fondé sur de soi-disant convenances que sur une authentique vertu , ce refus de partager a fait peser sur trop de jeunes des contraintes pour des faits dont ils n’étaient en rien responsables. Devenus hommes ou femmes ils les reproduisent et c’est une chaîne sans fin d’enfants désespérés, de mères solitaires et de pères exclus.
Jean-Paul, quinze ans, arriva en France. Il était particulièrement vif et intelligent. Il me prit à part et d’un trait, guettant ma réaction :
« Il ne faut pas vous étonner si mon père ne m’écrit pas. Il est officier, commandant même, mais sa tente a brûlé alors qu’il était en Algérie et il a perdu mon adresse… »
Bien sur, je ne lui ai pas demandé comment il savait tout cela et l’assurai que son père pensait sûrement beaucoup à lui. Quelques années plus tard – il venait de recevoir son diplôme d’ingénieur, il m’avoua :
« Je vous ai menti… je ne sais pas qui est mon père »
Qu’importe, il s’en était construit un qui, finalement l’avait élevé jusqu’à ce qu’il se sente suffisamment adulte pour affronter la réalité.
A travers les siècles et les continents, les hommes se sont construits des dieux faute de connaître le Dieu révélé qui s’est fait reconnaître comme père. C’est ainsi que, en contradiction avec l’enseignement du Bouddha, des disciples tardifs ont voulu l’affubler d’un caractère divin et donc le prier. Comment ne pas voir dans cette démarche un appel pathétique, une attente… ? Il n’a pas manqué d’esprits – parfois angoissés et qui méritent le respect à cause de cette angoisse – pour proclamer que la révélation sur laquelle les chrétiens fondent leur foi, était elle-même le fruit d’une construction.
Ainsi, la paternité de Dieu émergeait-elle peu à peu, comme en creux, de son expression humaine. J’avais beaucoup reçu et voici que j’étais témoin de l’appel désespéré de ceux qui n’avaient connu de paternité ni humaine ni divine.
Nghiem, dix-huit ans, arrive un dimanche matin sans préavis à la maison. Il a quitté son internat de province sans permission pour venir me signifier son intention « irrévocable » d’abandonner ses études pour rejoindre à l’autre bout de la France une certaine Martine rencontrée durant les vacances et sans laquelle il ne saurait dorénavant vivre. Nous sommes dans les années post soixante huit et, sans doute touché par l’air du temps, j’entreprends un long discours lui représentant la nécessité de terminer ses études, la fugacité des amours de l’été, la légèreté évidente de la demoiselle… enfin tout ce que je crois de nature à toucher ce jeune homme buté et amoureux. Rien n’y fait. (« Vous ne pouvez pas comprendre »). Nghiem est définitivement « ly », c’est-à-dire têtu. A courts d’arguments et surtout de patience, excédé, je coupe court :
« Ecoute moi bien, je suis ton tuteur, c’est-à-dire que je représente ton père. Eh bien! Tu vas prendre le premier train et rentrer immédiatement dans ton lycée ».
Alors Nghiem :
« Bon, je repars…. C’est cela qu’il fallait me dire tout de suite »..
Un temps :
« C’est que je n’ai pas l’argent pour le billet ».
Je ne demandais qu’à le payer. Nghiem est reparti vers ses devoirs de maths, a eu son bac. Quelques années plus tard, téléphone :
« Je voudrais vous présenter une fille… C’est pour vous demander la permission de l’épouser ».
« Martine? »
« Ah non! Pas celle-là ! c’est une nulle. Non, Phuong. Vous allez voir, elle est super ».
C’est vrai, Phuong était super. Nghiem de me présenter :
« Regarde bien tonton. S’il n’avait pas été là, tu ne serais pas là non plus! »
L’arrivée de ces enfants – ils étaient eurasiens, laotiens, vietnamiens, chinois, prit une autre dimension en 1976 lorsque le communisme – Pathet Lao au Laos, Khmers rouges au Cambodge et Viêt-cong au Vietnam – ayant pris possession des trois pays de l’ancienne Indochine, des centaines d’enfants isolés déferlèrent sur la France. René Péchard dut quitter le Laos. Nous avions sept cent pupilles en France, pour la plupart d’origine eurasienne et placés dans des familles. Ils tombèrent dans un pays qui s’évertuait à tuer l’image du père alors qu’eux-mêmes ne vivaient que par elle et pour elle. Le choc fut douloureux.
L’enfant ne demande pas un père qui vive en pantoufles, calé devant son poste télé. Le vrai père risque, il construit et s’aventure. A la maman d’expliquer l’absence, de l’aider à comprendre, de transcender une situation qui lui pèse parfois. Responsabilité immense. Que de drames ! Que de jeunes brisés par l’image que l’on a présenté de leur père, qui serait coupable, infidèle, se désintéressant de leur fils alors que les séparations sont souvent la conséquence de malentendus, de fautes partagées et, surtout le fruit d’une histoire bouleversée et d’une société devenue folle. Les mères s’accrochent souvent jusqu’à l’héroïsme à leurs petits mais, bénéficiant toujours d’un préjugé favorable, instruisent trop souvent un procès à charge contre leurs anciens conjoints. Alors, touchés à mort, les pères se lovent sur leur chagrin, lèchent une blessure jamais cicatrisée et, renonçant à se défendre, convaincus d’être coupables avant d’être jugés, s’écartent, instruisant eux-mêmes l’accusation. Vient le jour – il vient toujours – où l’adolescent veut comprendre, s’affronter, dire sa vérité, prononcer le verdict… Alors se rencontrent enfin deux destins souffrants qui auraient dû se fondre en un seul bonheur. Mais les plaies sont tellement vives que, le plus souvent la chance passe et chacun repart de son côté en remâchant sa douleur.
Ces situations nées de la guerre, les voici qui se multiplient aujourd’hui au sein de nos pays en paix. Les enfants sans père sont de plus en plus nombreux. Tellement nombreux que la société, se refusant toujours à affronter le problème a substitué la complaisance à l’intolérance. Les médias imposent la norme de familles « recomposées » qui seraient heureuses et équilibrées. Ce qu’on se refusait à assumer voici maintenant qu’on l’exalte. L’incantation sur les familles éclatées, voire sur les familles monoparentales et maintenant homosexuelles ne réussit pas à masquer les souffrances immenses dont nous sommes chaque jour témoins. Des pères absents par leur faute, des pères absents en raison des circonstances indépendantes de leur volonté, mais aussi des pères empêchés de tenir leur place tant l’arrogance de l’occident s’évertue à écraser des traditions millénaires. Combien de drames nés de la dévalorisation des pères ? Une dévalorisation due à l’imposition de valeurs artificielles prescrites par l’air du temps. Ainsi trop de jeunes occidentaux désorientés s’érigent-ils en procureurs à l’âge où les jeunes asiatiques s’efforcent au confucianisme.
Nhi seize ans à l’époque, m’en donna la meilleure définition. Avec son frère jumeau, nous étions allés présenter notre action dans le cadre d’une réunion de parents d’élèves. Ils m’aidaient à passer des diapositives. Je venais d’expliquer la hiérarchie qui organise les fratries, souvent nombreuses à l’intérieur des familles asiatiques : même entre ces deux frères pourtant nés à quelques minutes d’intervalle, cette hiérarchie existait. D’ailleurs, leur papa, surpris de cette double naissance en un temps et un lieu où l’échographie n’existait pas, les avait appelés Nhat et Nhi ce qui signifie tout bonnement « Premier » et « Deuxième ». J’avais remarqué que Nhi-Deuxième ne manquait jamais d’en référer à Nhat-Premier dans toutes les circonstances de la vie quotidienne. Une dame se leva :
« Ma question s’adresse à Nhi : cela ne te gène pas d’obéir à ton frère ?… surtout à ton frère qui a finalement le même âge que toi? »
Et le garçon de répondre sans hésiter :
-« C’est pour lui que c’est difficile ».
Après deux mille ans d’Evangile, il fallait que dans une salle du seizième arrondissement, ce soient de jeunes bouddhistes[2] qui remettent les choses en place. L’autorité n’est pas un pouvoir à conquérir mais un service à assumer.
« Vous, jeunes, obéissez à vos parents, car c’est un devoir. Honore ton père et ta mère : c’est le premier commandement accompagné d’une promesse : afin que tu réussisses et que tu aies longue vie sur la terre. Et vous, pères, ne soyez pas énervants avec vos enfants, mais éduquez-les avec des corrections et remontrances inspirées du Seigneur ». (Si, 30, 1 –13). :
Des lettres nous parvenaient qui commençaient ainsi :
« Cher tonton,
J’écris en cachette de ma mère (ou de ma famille adoptive). Surtout ne leur dites rien ! Voilà, je voudrais savoir qui est mon père. Je voudrais le retrouver pour comprendre ce qui s’est passé avec moi… »
René Péchard cherchait le dossier du jeune et, avant de l’ouvrir me disait :
« Vous allez voir, il doit avoir environ quatorze ans… »
C’était généralement le cas.
Dans les années quatre-vingt dix, arrivèrent des jeunes de la deuxième génération, élevés dans les banlieues où leurs parents s’étaient sont réfugiés en arrivant : jeunes Français aux yeux bridés et aux cheveux noirs qui parlent verlan, portent casquette (si possible à l’envers) et portable (en général à l’oreille… celle qui est percée d’une boucle), bref, affolent leur monde.
Déjeuner dans une famille. Le papa était colonel, il est aujourd’hui serveur dans un fast food des Champs Elysées. Il a réussi à faire venir sa famille après des années de galère administrative et d’économies (libéré trop tard le soir de son service, il dormait dans une entrée de métro pour éviter de prendre un taxi). Durant le repas, une brève altercation l’oppose à son fils aîné. Rien de grave mais avant de nous quitter, le père nous fait signe de le suivre dans la cuisine et, les larmes aux yeux :
« Je vous prie d’excuser l’inconvenance de mon fils…. Vous avez vu comment il m’a parlé ! »
Je lui explique que, moi aussi, j’ai un fils de cet âge et qu’il ne faut pas y attacher d’importance …
« Peut-être, mais dans notre pays, nous respectons la piété filiale. Jamais je n’aurais osé parler ainsi »
Nous prenons congé. C’est au tour du garçon de me rattraper dans l’escalier.
« Je vous prie d’excuser mon père !… Vous avez vu comment je lui ai parlé ? Eh bien, il ne m’a rien dit ! Il n’ose rien me dire. Pourtant, grand-père m’a expliqué que jamais il n’aurait accepté que papa lui parle comme cela. C’est comme pour mes notes, il n’ose rien me dire parce qu’il dit qu’il est ouvrier. Mais, moi, ça m’est égal, c’est mon père et, moi, je suis vietnamien ».
et le gosse d’éclater en sanglots.
C’est Jean-François, même âge : « Mon père n’ose jamais rien me dire. Il a peur de moi et moi j’attends qu’il m’empêche de faire des bêtises. Mais quand il veut me punir, ma mère l’en empêche ».Il sait à peine lire et écrire parce que lorsqu’il a commencé à faire l’école buissonnière, sa mère a rédigé de fausses attestations.
C’est ce père de famille qui est convoqué au commissariat pour récupérer son garçon surpris à dérober un disque. Il est mineur et les parents se voient tenus d’accepter l’intervention indiscrète d’une dame psychologue. Elle débarque dans la famille, s’immisce dans l’appartement jusqu’au jour où le gosse excédé la met à la porte
« C’est l’affaire de mon père ! Pas la sienne ! »
C’est ce cauchemar vécu par une famille d’origine laotienne : une camarade de classe raconte à ses parents que sa petite amie de onze ans fait la sieste sur le même lit que son papa. Les parents alertent les services sociaux qu’ils ont eu quelques raisons de bien connaître. Sans plus se renseigner, ceux-ci signalent la chose à la police qui convoque le père. Il parle mal Français, ne comprend rien à ce qu’on lui reproche – et pour cause car dans son pays tous dorment sur un bas flanc commun. Victimes des fantasmes de ceux qui l’ont dénoncé, il est placé en détention préventive. Motif : « Ne se rend pas compte de la gravité de ses actes » ! Il faudra des mois à notre avocat pour l’en faire sortir…. L’affaire s’est terminée par un non lieu. Restent une petite fille soumise à des interrogatoires qui la souilleront pour la vie, une épouse victime de pressions scandaleuses pour la pousser au divorce, un homme blessé.
C’est ce sujet de devoir dans une classe de seconde technique : « Racontez vos difficultés avec vos parents et le problèmes qu’ils vous posent ». Tien, seize ans commence ainsi. « Ce n’est pas eux qui posent des problèmes, c’est moi. Je dois apprendre à mieux leur obéir… ». Il a zéro avec l’annotation : « Hors sujet… ». Zéro comme ces élèves des pays totalitaires qui se refusent à trahir leurs pères « fantoches ».
C’est Jean-Louis, dix-sept ans, il vient d’avoir son bac. Il est manifestement sensible et intelligent. Les yeux à terre, la tête rentrée dans les épaules. Il est l’aîné d’une famille nombreuse qui sombre dans la spirale infernale de l’exclusion.
« Tu veux que je te dise la vérité ?
Allez-y.
Il a commis des actes inadmissibles envers son père. Je le lui dis.
« Tu as des excuses ?
Non, aucune ».
Un silence, puis, dans un souffle :
-« J’ai honte de lui.
-« Eh bien, moi, je l’admire ! »
Et je lui dis pourquoi, car il a, c’est vrai un père admirable, mais tellement loin des clichés véhiculés par la télévision. Un père qui pratique un héroïsme au quotidien dans des conditions qu’un garçon de son âge ne peut comprendre (mais que sa plus jeunes sœur, plus intuitive a bien perçues). Il sait que je lui dis vraiment ce que je pense et le voilà qui relève la tête, manifestement passionné. Un silence, puis :
-« Je vais aller lui demander pardon ».
Nous étions au plus fort de la vague des films X . Minh, dix-sept ans, me confia, un jour où j’allais lui rendre visite dans son internat :
« Le samedi, je vais au ciné, ils ne passent que du porno; je sais bien que ça me fait du mal, mais je ne peux pas m’en empêcher… Ils laissent passer tout le monde, même les mineurs comme moi. Il faudrait aller leur dire de m’empêcher d’entrer… ».
Ce que nous fîmes, ensemble, au grand effarement du guichetier.
Que de confidences qui ne peuvent trouver leur place ici, mais qui témoignent de l’immense gâchis qu’une société, soudain devenue folle à force d’être gâtée, allait provoquer dans la jeunesse ! Bien sûr, les plus vulnérables seraient les premiers blessés et c’est ceux-là qui resteraient directement à notre charge. Pourtant, que de potentiel chez ces jeunes parfois si atteints par la vie! Nous allions nous habituer, ma femme et moi, à recevoir des coups de téléphone de jour comme de nuit, ou encore à voir s’encadrer dans la porte un Loan ou un San, l’air plus ou moins piteux :
« J’ai f… le camp de chez le patron. »
« J’ai fait une… bêtise. »
« II faut que je vous parle d’un problème. Voilà, elle s’appelle Stéphanie… »
Une fois, c’était un lycée privé situé à trois cents kilomètres. Par téléphone, on me mettait en demeure de récupérer un certain Jérôme qui, du haut de ses dix-sept ans, avait « dit son fait » au prof de philo dans une lettre ouverte particulièrement vigoureuse. Il n’en était pas à son coup d’essai mais, cette fois-ci, la coupe était pleine; j’avais jusqu’au soir pour venir le prendre. Par la force des choses, nous commencions à avoir des relations dans tous les établissements scolaires de la région. Je téléphonai au supérieur de l’institution Join-Lambert à Rouen. Il me répondit simplement :
« Dites à Jérôme que je le prends tout de suite. »
Je fis la commission :
« Vous lui avez dit ce que j’avais fait et il me prend comme ça, sans rien demander? Eh bien! il ne le regrettera pas!»
A la fin de l’année, Jérôme avait son bac et s’était taillé une réputation d’élève modèle.
Une autre fois, c’était, à deux heures du matin, un appel affolé :
« Oncle ! Je suis dans une cabine en gare d’Amiens. Je sens que je vais faire une bêtise. Je vous appelle. Ça va couper dans une minute… »
Oui, ils disaient « oncle » ou « Tonton » et il fallait justifier cette confiance. Alors pendant ces années, ma femme et moi avons connu l’inquiétude, l’angoisse de tous les parents du monde, et ces grandes joies des jours de victoire :
«Ça y est, j’ai mon C.A.P.,… mon bac!»
Ou encore :
« Vous savez, Stéphanie, dont je vous avais parlé, eh bien! je crois que nous allons nous marier… ».
En écrivant cela, tant de noms me reviennent à la mémoire! Ceux des jeunes, bien sûr, mais aussi ceux de tant de familles qui ont pu faire la même expérience.
René Péchard continuait son action au Laos. Nous entretenions une correspondance quasi quotidienne en utilisant des feuilles par question réponse sur papier carbone. J’en ai conservées des doubles. Une partie des siens ont été détruits au moment de la prise de pouvoir par les communistes. D’autres avaient été sauvés grâce à l’action de personnes courageuses qui les avaient passés au péril de leur vie, de nuit à travers le Mekong dans des sacs en plastique. Ces archives si précieuses ont été malheureusement détruites ultérieurement et avec elles les racines de destins que nous étions seuls à connaître.
Ses premières missives commençaient par « cher monsieur » puis « cher ami » avant de s’arrêter à « cher Jean Claude ». Nous nous sommes toujours vouvoyé, je l’appelais « tonton » comme tout le monde. Elles commençaient souvent ainsi :
« Dites oui tout de suite !… Voilà, j’ai ici un garçon qui doit partir immédiatement, Il faut lui trouver une famille… ».
Je trouvais une famille, comptant sur son voyage suivant pour tout consolide.
René Péchard : « Je venais régulièrement tous les deux ans, jusqu’à votre dernier voyage en 1975. Je me souviens particulièrement de mon voyage de 1970. Il fut un peu différent, puisque, après avoir revu le Nord, je me rendis à Strasbourg et à Mulhouse où d’anciens amis de l’Association, qui avaient déjà aidé à l’installation des jeunes prothésistes dentaires, acceptaient de devenir délégués. Ils nous ont beaucoup aidés pour suivre les jeunes qui faisaient leurs études dans ces villes ou se trouvaient en apprentissage de prothèse dentaire. J’ai visité des amis du Jura qui avait accueilli des enfants de chez nous et je suis également passé par la Savoie. Après quoi, j’ai repris ma première tournée en allant à Grenoble et Valence.
En 1972, j’avais refait une tournée et revu une grande partie des familles d’accueil. En 1974, une fidèle secrétaire que nous avions depuis neuf ans m’accompagna tout au long du voyage. Nous avons refait la même tournée, faisant des réunions par-ci, par-là, et des projections de diapositives sur notre travail au Laos. Chaque fois, nous étions reçus avec le même enthousiasme par nos délégués ou par les familles que nous avions l’occasion de rencontrer. Le voyage s’est terminé au début de juillet, avec la première grande rencontre de l’association en France. Ce fut d’abord le fruit de l’organisation du père Joël. Il avait été, vous vous en souvenez, coopérant au Laos et directeur de notre foyer de Vientiane. A l’abbaye de Mondaye, aidé par plusieurs de ses frères, il nous offrit une magnifique rencontre. Avec une importante participation des municipalités voisines et une information bien faite, plus de trois cents personnes se réunirent. Quelle émotion lorsque je vis deux frères qui, dans la tourmente de la guerre au Laos, s’étaient perdus de vue ! Je les avais envoyés en France à deux moments différents : devant nous, ils se retrouvèrent et s’embrassèrent après des années de séparation.
Ce sont des scènes de ce genre qui nous récompensaient en un instant de tous les efforts consentis, de toutes les difficultés inhérentes au type d’action que nous menions.
Le premier rassemblement fut vraiment un succès et un gros encouragement. On y a vu la qualité d’attachement de toutes les familles d’accueil et le nombre des bienfaiteurs qui nous épaulaient. L’organisation en France était maintenant bien rodée, et cela nous permit par la suite de faire face aux difficultés qui nous attendaient ».
Jean-Claude Didelot : « Ces rencontres nationales – et même internationales – se déroulèrent ensuite dans différents lieux, chaque année, sans interruption jusqu’à mon départ de l’association en 2001. Elles demandaient beaucoup de travail de la part des délégations concernées… qui en étaient récompensées par une ambiance familiale et joyeuse. Au long de toutes ces années, les anciens du Laos, de Fourmies, de Rosny sous Bois, de Valence, des maisons de la région Parisienne, avaient fait souche à travers la France. C’était pour eux l’occasion de se connaître, de se reconnaître, de faire connaissance avec les plus jeunes. Une messe, une cérémonie du Baci, l’accueil de bonzes venus de pagodes proches, témoignaient de la fraternité ouverte que René Péchard avait si bien su générer. L’Association était devenue une immense famille qui montra son efficacité lorsqu’il fallut replier l’association en France et accueillir le déferlement des boat people. »