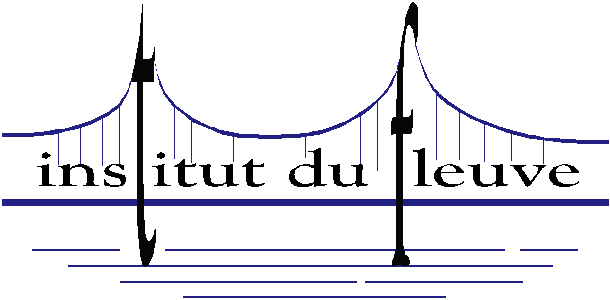1912 – 1957
Résumé
René Péchard naît le 2 avril 1912 à Trévoux dans une famille modeste. Son père avait été tué pendant la Première Guerre mondiale et sa maman a bien du mal à l’élever avec son frère. Elle est très pauvre et, travaille du matin jusqu’au soir, se passant de repas pour pouvoir lui donner le nécessaire…. Elle se remarie. A dix-sept ans, il part dans la marine où, très vite ses engagements auprès de la jeunesse commencent… .
1939. C’est la guerre. Il se marie (un mariage raté mais auquel il sera fidèle) et, mal conseillé par des prêtres inquiets de la montée du bolchevisme, croit faire son devoir en rejoignant en 1943 la Légion des Volontaires Français. Il est opposé à l’idéologie nazie, mais est influencé par l’attitude du maréchal Pétain…
Les recrues sont regroupées dans un camp en Pologne où il refuse d’aller plus loin à la vue de l’uniforme qu’on leur impose. Arrêté par les Allemands, il est menacé d’être exécuté et enfin jeté sur les routes. Il rentre clandestinement en France. Engagé pour la durée de la guerre, le 20 mai 1945, sous un nom d’emprunt dans la Légion étrangère, il rejoint Sidi Bel-Abbès d’où il embarque le 10 Janvier 1946 avec le 2e Régiment Etranger d’Infanterie affecté à la pacification du Sud Annam. Promu caporal, il est démobilisé le 2 septembre 1948 avec un certificat de bonne conduite et le droit au port de la Médaille Commémorative de la Campagne d’Indochine.
Il s’installe à Phan Thiet où il ouvre une infirmerie et soigne les malades. Arrêté par le Viêt- Minh, il va être détenu durant sept années, tantôt libre de ses mouvements, tantôt incarcéré dans des conditions très difficiles, il est ramené dans le nord, à pied où il est traduit devant le tribunal du peuple. Il s’évade au moment des accords de Genève. Arrivé à Hanoi en mars 1955, il n’en repart que le 20 septembre 1956 pour Vientiane au Laos.
Trahi par un coreligionnaire, mais sauvé par un jeune vietnamien chargé de le surveiller, il restera marqué à vie par cette expérience qui lui avait appris à aller au delà des apparences et à aimer, par delà les idéologies, les peuples les plus pauvres d’Asie.
*
Jean-Claude Didelot, né en 1939 dans une famille d’officiers (son père est un ancien de la 2e DB) est à la même époque élève au lycée Janson de Sailly puis au Prytanée Militaire de la Flèche.
|
Audio
|
Photographies |
Extraits de « Piété Filiale »[1]
[1] Editions du Jubilé.
R Péchard : « Mon enfance a été très simple[1]. Mon père a été tué au cimetière de Blain-Saint-Nazaire pendant la Première Guerre mondiale et ma pauvre maman a eu bien du mal à nous élever, mon frère et moi. Un cousin a pris chez lui mon frère aîné, qui était presque en âge de travailler, et je suis resté seul avec notre mère. Je n’ai connu mon frère que plus tard ».
………
JCD : Je devais rencontrer, quelques années après sa mort, ce frère aîné devenu très âgé. Il me dit : « Mon frère était un saint ». Sa mère accueillit plus tard un autre enfant qu’il considérait comme son frère et avec lequel il entretint toute sa vie des liens étroits. Cet enfant était d’origine juive ce qui explique peut-être les risques qu’il prit durant la guerre pour passer des enfants juifs en zone libre. Il était alors responsable de colonie de vacances.
…………..
R.P. : « Il y avait à la colonie un enfant juif qui était menacé par une rafle. Il fallait le faire passer en zone libre. Je l’ai emmené avec moi par le train, qui, comme cela était souvent le cas durant cette époque troublée, était bondé… à l’exception d’un wagon réservé aux officiers de la Wermacht. J’ai avisé un commandant qui occupait à lui tout seul un compartiment et lui ai servi une histoire d’enfant malade que je ramenais chez lui. Tout ému, ce brave homme, qui avait l’allure d’un père de famille, l’a fait étendre sur la banquette inoccupée et m’a fait asseoir à coté de lui. Au moment de passer la ligne, la police a ouvert la porte. Je n’en menais pas large ! J’avais soigneusement expliqué à mon petit fugitif la conduite à tenir : il feignait de dormir et je crois même qu’il s’était endormi pour de bon. L’officier a fait signe de ne pas faire de bruit, le feldgendarme a claqué les talons et nous sommes passés sans même qu’il me demande mes papiers… Je ne sais si notre passeur involontaire avait été dupe. Vous voyez, il y a partout des gens qui ont du cœur. On ne voyageait pas comme maintenant…
« Je pense que c’est à ma mère que je dois tout ce que j’ai accompli, le peu que j’ai fait, parce qu’elle m’a vraiment appris à aimer. Elle était pauvre, très pauvre et, bien souvent, travaillait sur sa machine à coudre du matin jusqu’au soir. Elle me faisait dîner de bonne heure pour que je puisse aller me coucher; j’étais enfant et ne m’inquiétais pas de ce qu’elle pouvait manger. Ce n’est qu’après que j’ai compris qu’elle se passait de repas le soir pour pouvoir me donner le nécessaire. Bien que pauvre, elle était vraiment charitable; elle ne pouvait pas donner d’argent aux nombreux mendiants qui parcouraient la France après la guerre de 1914-1918, mais lorsque l’un d’entre eux frappait à notre porte, on ajoutait une assiette et nous mangions tous ensemble. Le souvenir de ma mère restera à jamais gravé en moi. Je la revois dans mon souvenir ouvrir à tel mendiant, ajouter un couvert et nous tous partager le repas… Bien souvent, quand il m’a été donné d’aider des femmes seules se débattant dans d’horribles difficultés avec leurs enfants, je pensais à ma mère et c’est, je crois, son souvenir qui, ma foi aidant, m’a fait aller de l’avant, en des circonstances difficiles. C’est également la pensée de ma mère qui m’a stimulé pour donner vie à l’association.
Je suis allé à l’école primaire, j’ai fait là mes premières études, puis ma mère s’est remariée, un mariage de raison. A dix-sept ans, je suis parti dans la marine, puis très vite mes engagements auprès de la jeunesse ont commencé…
J’ai souhaité ensuite devenir prêtre, mais j’ai compris très vite que cela me serait impossible. Quand j’étais adolescent, la formation du prêtre ressemblait peu à celle que l’on connaît aujourd’hui. Le petit séminaire était un internat complètement bouclé. En vacances, on se retrouvait sous le contrôle sans complaisance du curé de nos paroisses. Même chose pour le grand séminaire. Je n’en conclus pas que la foi était différente de ce qu’elle est de nos jours. Simplement, elle s’exprimait d’une autre manière parce que le contexte se présentait différemment. Le concile Vatican II a apporté sur ce plan bien des changements positifs dont les générations actuelles ont certainement du mal à se rendre compte. La foi est une réalité qui ne change pas. Ce qui change, c’est peut-être la façon de l’exprimer. Je me suis donc arrêté, sur les conseils de mon directeur de conscience d’alors. La guerre d’Indochine a éclaté : je suis parti là-bas… »
JCD. Dans la période troublée des années de guerre, sans doute aussi, attristé par un mariage raté mais auquel il fut fidèle toute sa vie, mal conseillé par des prêtres inquiets de la montée du bolchevisme, il avait cru faire son devoir en rejoignant la Légion des Volontaires Français à la fin de la guerre en 1943. Il n’était certes pas animé par l’idéologie nazie, ni par une connivence avec l’Allemagne en guerre, mais sans doute fut-il influencé par l’attitude du maréchal Pétain auquel ce fils de mort pour la France portait une confiance partagée par la majorité de la population[2]…
– « Une erreur, je me suis fait avoir par Doriot[3]…. » Me dira-t-il en évoquant ce douloureux épisode.
« Une erreur », certes, mai, en ce qui le concerne, pas une faute : les recrues étaient regroupées dans un camp en Pologne où ses yeux se décillèrent à la vue de l’uniforme qu’on leur imposait. Il refusa d’aller plus loin. Ils ne seront que soixante dix sur deux mille à se rebeller. Arrêtés par les Allemands, ils sont menacés d’être exécutés et enfin jetés sur les routes. Les troupes alliées ont débarqué en Provence et remontent vers le nord. René Péchard passe par la Suisse, se réfugie dans une abbaye, rentre clandestinement en France et se portant au devant de l’armée Française, s’engage pour trois ans, le 20 mai 1945, sous un nom d’emprunt dans la Légion Etrangère ….
On ne faisait pas de détails à cette époque et il sera condamné par contumace. Plus tard, il bénéficiera d’une amnistie personnelle du Président de la République, il en souffrira toute sa vie et j’aurai à lutter à ses cotés contre ceux qui trouveront là prétexte à l’écarter quitte à détruire son oeuvre. Du moins conservera-t-il de cet événement malheureux une grande compréhension pour les plus jeunes dont la générosité est fourvoyée par des adultes sans scrupules.
Le proscrit embarque à Marseille pour Oran le 30 juin 1945. Il repart le 10 Janvier 1946 avec le 2e Régiment Etranger d’Infanterie qui, issu du Régiment de marche d’Extrême Orient, venait de reprendre son appellation d’origine. Placés sous les ordres du colonel Lorillot, le régiment se composait d’une compagnie régimentaire et de trois bataillons. Il avait pour première mission d’assurer la pacification du Sud Annam, vaste région s’étendant sur 500 kilomètres en bordure de la mer de Chine, des marécages cochinchinois à la barrière rocheuse du cap Varella. Les trois bataillons sont implantés dans les trois provinces de Tanh Hoa, Nha Trang, Thaurang et Phan-Thiet. Ils auront à faire face à une guerre de guérilla extrêmement meurtrière. Débarqué à Saigon le 6 février, il est affecté à la 3e compagnie, nommé 1ére classe le 1er octobre, et caporal le 1er juin 1947. Titulaire d’un congé de fin de campagne valable du 1er mai au 1er septembre 1948, il sera libéré et rayé des contrôles de la Légion Etrangère le 2 septembre1948 avec un certificat de bonne conduite et le droit au port de la Médaille Commémorative de la Campagne d’Indochine.
R. P. : « Le pays était divisé de fait en deux parties : l’une, sous l’autorité du gouvernement Hô Chi Minh, vivait dans les montagnes et se réclamait du communisme; l’autre, au contraire, faisait cause commune avec les Français. En réalité, les options personnelles étaient moins nettes. Du côté communiste, le nombre des pro-Français était important, mais ils étaient bien évidemment condamnés au silence. Du côté français également existaient des procommunistes qui devaient se taire par sécurité. Je les ai connus. Je pensais que c’était leur droit de penser ce qu’ils voulaient, dans la mesure où leur adhésion intérieure ne les encourageait pas à nuire aux autres. Dire que cela me réjouissait serait mentir. J’ai toujours souffert des divisions, des déchirures. La violence m’a blessé à de nombreuses reprises…
Pour revenir à moi, je dois dire que, durant cette guerre fratricide, je me suis contenté de soigner les malades, d’essayer d’apaiser les souffrances et les misères. Ce n’était guère facile. Un beau jour, alors que j’étais en train de soigner des gens dans un village et que j’avais maintes fois rencontré des Viêt-minh qui m’avaient laissé tranquille, ils sont venus me chercher et me dire qu’ils avaient reçu l’ordre de leur gouvernement de me « protéger » sans que je sache trop pourquoi.
JCD…. « sans que je sache trop pourquoi… » En réalité, René Péchard le savait et me l’a raconté. Lorsqu’il est libéré de son engagement, il est « maintenu en Indochine par cas de force majeure pour jouir de son congé de fin de campagne » par le colonel commandant son régiment. La force majeure, c’est la condamnation par contumace dont il est encore frappé en France. Fidèle à ce qu’il a toujours été, il se met à soigner les plus pauvres sans s’inquiéter de leur appartenance ce qui le rend suspect aux autorités des deux camps. Un nouveau responsable, moins humain que son ancien chef, le contraint à aller se faire démobiliser en France. Il y retrouve pour quelques heures sa maman qu’il n’a pas vu depuis des années et qu’il ne reverra plus puis se rend au siège de la Légion pour les formalités. Dés lors, n’étant plus protégé par son statut de légionnaire, il n’a d’autre choix que de réembarquer clandestinement à bord du paquebot des Messageries Maritimes qui l’avait amené, aidé par l’équipage où il s’était fait des amis.
De retour en Indochine, il reprend ses soins aux malades. Il découvre un trafic : un fonctionnaire français détourne à son profit des médicaments qui auraient dû faire l’objet de distributions gratuite. Sans hésiter, il va trouver la personne concernée. La discussion est vive. Un boy vietnamien entre pour servir une boisson et ressort silencieusement. Quelques jours plus tard, alors qu’il se trouve dans un village écarté, il est arrêté par le Viet Minh. On lui signifie que son attitude en faveur des plus pauvres a conduit le président Ho a donner des ordres pour qu’il soit « protégé »…. En réalité, il s’agit de l’écarter comme le seront systématiquement ceux dont l’action humanitaire contredisait la propagande du parti. D’ailleurs il ne tardera pas à s’apercevoir que cette « protection » était en réalité une arrestation.
Détention.
R.P. : « Ils m’ont emmené et, là, j’ai connu des fortunes diverses. D’abord, dans un service situé au cœur du maquis, on m’a laissé un peu tranquille et j’étais respecté. Trois mois plus tard, on m’a conduit jusque dans la province de Binh Dinh et, à cet endroit, n’étant plus militaire mais civil, j’ai obtenu de rester libre. J’avais une paillote, j’étais chez moi et je possédais même l’autorisation de circuler dans les quatre provinces. Peu après, j’ai compris le pourquoi de cette « largesse » : les autorités avaient tout intérêt à avoir quelqu’un qui soigne les malades. En l’absence quasi totale de vrais médecins et de vrais dentistes, ils m’ont laissé libre de circuler. Puis un jour, sans doute à la suite d’une dénonciation, j’ai été arrêté. On ne m’a pas mis dans un camp, mais carrément en prison.
Au tout début, m’échapper aurait été rien moins que très difficile : je n’aurais pu faire un kilomètre sans rencontrer des Viêt-minh qui, reconnaissant mon type français, m’auraient immédiatement arrêté. Il n’en était donc pas question. Je dois reconnaître que durant les deux premières années, c’est-à-dire jusqu’en 1952, les Viêts ont été corrects à mon égard
Malheureusement, très vite les Viêt-minh m’ont à nouveau jeté en prison et, là, les gardiens furent sans complaisance. Toutes ces péripéties m’ont incidemment permis d’avoir des contacts avec le responsable du bureau politique Viêt-minh de la région. Une histoire cocasse, comme vous allez le voir… Pour rendre service, car je ne suis pas diplômé en art dentaire, je faisais le dentiste ambulant, en charriant des boîtes de matériel avec, dedans, daviers et seringues. Lorsque je me rendais à la Sûreté pour faire renouveler mes papiers, j’avais toujours quelques dentitions à nettoyer, quelques molaires à extraire, gratuitement bien entendu. Au moment où l’on m’avait mis en prison, je m’étais séparé d’une boîte de verres d’essai pour opticien, au profit d’un homme qui me les avait achetés pour se fabriquer des lunettes. J’ai reconnu les verres en question, ainsi bien sûr que le propriétaire. Il est passé près de moi et m’a dit : « Je voudrais bien que vous voyiez cette dent… » II s’est assis, a ouvert la bouche, et le verdict est tombé : « Cette dent est en très mauvais état; il faudrait impérativement suivre un traitement. » En matière de médicaments, je me trouvais complètement démuni, aussi ai-je ajouté : « Si vous arrivez à trouver ce qui est nécessaire pour arrêter l’infection, on pourra faire quelque chose. Sans cela, l’extraction s’impose! – Allez-y, me répondit-il… Cette cochonnerie me fait très mal, surtout la nuit. » Après une rapide anesthésie, je lui pris délicatement la dent entre mes pinces et, sans la serrer trop, je lui dit : « Monsieur San, vous n’êtes pas gentil avec moi. Il y a longtemps que j’ai demandé à vous rencontrer et vous n’avez jamais répondu à mes demandes. » II me repoussa le bras et s’exclama : « Vous me connaissez donc ? – Bien sûr que je vous connais! Vos verres sont un signe de reconnaissance. Je n’ignorais pas qu’ils avaient été achetés par un chef de bureau, et des verres d’essai de ce genre, croyez-moi, n’ont existé qu’en un seul exemplaire… » L’homme a souri :
– « Bon, arrachez cette dent et venez me voir dans mon bureau! »
Quinze jours plus tard, en pleine nuit, un soldat en armes vint me chercher.
– « M. San veut vous voir, habillez-vous! »
J’étais plutôt inquiet et craignais un piège. En fait, il n’en était rien. L’enfant du chef du bureau politique, frappé par le scorbut, saignait abondamment des gencives. Le soldat m’en avait averti, aussi avais-je apporté une ampoule de coagulant qui me restait et des pansements. Cela se révéla insuffisant. Je craignais une infection en l’absence de pénicilline. J’ai pensé que l’autorité de M. San serait suffisante pour obtenir, même en pleine nuit, des médicaments à la pharmacie d’État. J’ai donc rédigé une ordonnance et le soldat est parti à bicyclette. Il est revenu deux heures après avec les médicaments et j’ai passé le reste de la nuit auprès de l’enfant. L’hémorragie s’est enfin arrêtée. Je ne suis pas sûr d’avoir été la cause de l’heureuse issue, mais M. San me garda toujours une grande reconnaissance et, par la suite, il chercha à me faciliter les choses. Je dois dire que c’est dans cette zone que j’ai été le moins malheureux. Je n’ai pas réellement souffert, sinon du manque de liberté.
Je n’ai jamais eu la preuve de ce que j’avance, mais je suis à peu près sûr d’avoir été dénoncé par un prisonnier jaloux de ma situation. Il a raconté que, la nuit, je me rendais en cachette au bord de la mer pour y faire des signaux aux bateaux français croisant au large. Dans la position qui était la mienne, un tel comportement eût été impossible, mais cette dénonciation dont mes gardiens eux-mêmes m’avouèrent l’inanité suffit néanmoins à transformer la relative « liberté » qui était la mienne en véritable incarcération ».
Les Viêt-minh répétaient inlassablement que le travail était un honneur. Ils respectaient celui qui travaillait. Une anecdote significative pour illustrer cela : après qu’on m’eut enlevé les fers et mis en cellule, je fus autorisé à voir mon dossier au tribunal militaire central. Ces papiers, qui m’avaient suivi tout au long des mille kilomètres de mon périple, mentionnaient que, n’étant pas occupé tout le jour par ma « profession », j’avais créé un potager de toutes pièces. Le dossier allait jusqu’à signaler de simples détails : j’avais, disait-il, planté des patates et du manioc afin de pouvoir construire ma paillote avec le fruit de ma culture; il précisait également que j’avais, à l’aide d’une immense jarre, confectionné des «toilettes» de campagne et que je ne répugnais pas à puiser dedans pour avoir de l’«engrais». A titre documentaire, notez que c’est un mode de fumure très répandu dans l’ensemble de l’Extrême-Orient.
Pour des Vietnamiens, qu’un Français se soit comporté de la sorte étonnait grandement. Cela a eu une influence positive sur ceux qui ont eu mon dossier personnel en main.
Après un certain nombre de semaines, on nous a dit que nous allions partir vers le nord, pour rejoindre la France en passant par la Chine et la Russie. Nous y avons cru et nous avons été nombreux à nous porter volontaires pour ce voyage qui, pensions-nous, serait sans doute pénible, les conditions ne seraient pas tendres, mais ne manquerait pas d’intérêt par ailleurs. Nous avons repris le chemin de la montagne. Tous ces voyages ont évidemment été effectués à pied. On mettait parfois trois mois pour se rendre d’un lieu à un autre. Nos gardiens nous faisaient passer par des espèces de sentiers « muletiers » afin d’éviter les bords de mer qu’occupaient les troupes françaises. Lorsque nous sommes arrivés à Vinh, il n’était plus question de retourner dans l’Hexagone… et il n’était plus question pour moi de pouvoir circuler. J’étais au camp et je faisais l’objet d’une surveillance particulière. Une continuelle suspicion pesait en permanence sur moi jusqu’au jour où, sans motif exprimé, on m’a arrêté à nouveau, jeté en prison et traîné devant le tribunal militaire de la 4e zone. Là, je suis resté aux fers durant plus de cinq mois, dans une cellule à trois, en compagnie de condamnés à mort. Inutile de dire que j’ai été très vite convaincu intérieurement que j’allais partager leur sort. Tout m’encourageait à le croire : les traitements, l’attitude des gardiens. Lorsqu’il me fut annoncé qu’on allait me transférer dans un autre lieu, j’ai cru qu’il s’agissait d’un mensonge, ou plutôt d’un prétexte, pour m’éliminer sans bruit. J’avais entendu parler à de nombreuses reprises de ces prisonniers exécutés au coin d’un bois, d’une balle dans la nuque…
Notre cortège à trois s’est organisé au petit matin. Nous étions attachés par une simple ficelle dont le bout était tenu en main par une sentinelle. Après quelques heures de marche, comparution une nouvelle fois, mais devant un autre tribunal militaire, celui de Thai Nguyên. J’ai d’abord été mis aux fers. Imaginez une planche rugueuse sur laquelle il était impossible de se retourner. J’ai vécu là des moments difficiles, je dirai même très durs. Au bout de deux jours de ce traitement, appel du chef de camp.
– « Je ne comprends pas pourquoi vous avez été arrêté » me déclara-t-il.
Pas mal énervé, je lui ai rétorqué qu’il me plairait également de connaître les raisons de mon arrestation.
– « Si c’est la manière que vous avez choisie de remercier ceux qui veulent soigner vos compatriotes, elle est tout de même un peu particulière. »
Mon geôlier me recommanda alors très gentiment de ne pas m’énerver. Mon cas allait être examiné avec soin. En attendant, on allait me donner un peu plus de « liberté » ; je ne serais plus attaché qu’avec un fer. Compensation dérisoire, allez-vous penser… On a du mal, en dehors de l’expérience vécue, à imaginer ce que peut être un allégement de détention quand on a vécu dans l’inconfort total, au bord de la tétanie des membres… et de la tête. Que de pensées, que de prières vous passent par la tête avec des teintes d’espérance et souvent aussi de découragement, voire de désespoir! Cet état de pauvreté presque absolu fait de vous un pauvre qui apprécie toutes les petites choses grâce auxquelles se profile à l’horizon la perspective éventuelle d’une amélioration et, qui sait ? d’une libération. Après deux journées de semi-captivité, nouvelle entrevue avec le responsable du camp. Mes fers me sont définitivement enlevés et, avec eux, les crampes et ces blessures qui s’infectent si facilement avec le frottement sur la peau toujours humide de transpiration.
Trois jours d’attente encore, et transfert dans une cellule devant laquelle se trouvait une petite cour. Tous ces détails vous paraîtront peut-être superflus, mais, après toutes ces années, je me souviens de ces endroits avec une totale netteté. Quand on n’a rien d’autre à faire qu’à attendre, Tout ressort, tout prend un extraordinaire relief. Un ami à moi qui a été incarcéré à Fresnes m’a raconté qu’au bout de trois semaines de prison il connaissait par le détail tous les graffitis des murs de sa cellule. Il savait que « Pierre aimait Sylvia », que « Marcel avait prié la Sainte Vierge avant d’aller devant le peloton d’exécution », et tant d’autres phrases glorieuses ou lamentables, signe d’un courage ou d’une défaillance face à l’inéluctable. Chez les paysans du Nord, quand je suis arrivé dans Hanoi occupée, je n’ai jamais perçu de ressentiment ni d’hostilité. Nos sentinelles, lorsqu’elles se trouvaient en groupe, étaient souvent très rudes à notre égard. Certains des nôtres ont été frappés et durement punis. En revanche, lorsque les soldats étaient seuls et faisaient leur ronde le soir dans notre prison – une paillote isolée des autres -, ils tiraient de leurs poches quelques friandises, une poignée de tabac, et nous les donnaient, en regardant soigneusement s’ils n’avaient été vus par personne. Dans tous les conflits, les ex-prisonniers racontent des histoires de ce genre. Contrairement à ce que l’on dit, l’homme ne saurait être toujours un loup pour l’homme, et la bonté, la pitié demeurent présentes dans les cœurs et ne demandent qu’une occasion, un instant de silence pour s’exprimer. Quand nos gardiens montaient la garde à deux, ils redevenaient secs et sans complaisance : dans le régime mis en place au Viêt-nam du Nord, les soldats étaient structurés en cellules de trois et chacun était chargé de surveiller les deux autres; un véritable cauchemar, l’« espionnite » érigée en système… Ces gens vivaient et, probablement, vivent encore dans une atmosphère de terreur, de délation perpétuelle où l’on a peur même de son ombre.
Chez les gens des campagnes, nous avons toujours rencontré la plus grande amitié. Je me souviens que, nous voyant tous défiler sur un sentier de rizières, des enfants et des femmes venaient nous apporter de l’eau fraîche puisée dans leurs maisons. Le Français n’était pas haï, loin de là. Dans les meetings obligatoires, on le traînait dans la boue, on le taxait de « traître », de « valet de l’impérialisme international », de « colonialiste avide du sang des peuples », mais au fond, dès que les choses redevenaient réelles et sérieuses, rien de tout cela n’existait dans l’opinion profonde des personnes rencontrées. J’ai même été en contact avec des personnalités communistes au plus haut niveau qui se sont exprimées intimement : ces hommes éprouvaient un véritable attachement à l’égard de notre pays. Ils ne pouvaient le montrer et le cachaient soigneusement. Je suis persuadé que des amitiés durables auraient pu se nouer et se cultiver. Malheureusement, les circonstances ne nous ont pas permis de nous revoir et de communiquer.
Le sentiment chrétien dépendait des zones. En zone 5, par exemple, les catholiques semblaient n’avoir aucun problème pour pratiquer librement leur religion; personne n’aurait osé leur dire quoi que ce soit. Plus on montait vers le nord, plus on percevait la haine du religieux propre au communisme. Au sud, tout à fait au sud où je ne suis jamais allé, il y avait des aumôniers dans les troupes viêt-minh. J’ai eu l’occasion, au passage, de rencontrer deux de ces prêtres chez le curé d’un village. Ils avaient parcouru à pied la distance entre Saigon et les montagnes du Nord durant six mois et plus. Ils étaient en désaccord complet avec le curé qui les recevait et qui leur disait : « Comment pouvez-vous collaborer avec le pouvoir communiste et vous tourner vers Hô Chi Minh ? » Ces prêtres étaient tout à fait sincères. Ils répliquèrent : « Vous ne pouvez pas dire des choses de ce genre. Notre gouvernement est loin d’être marxiste… » Ces hommes se battaient pour l’indépendance de leur pays et ils ne faisaient pas de politique. On les entretenait dans la douce illusion d’une unité nationale qui se construirait par-delà les idéologies et qui déboucherait sur un Viêt-nam libre où chacun pourrait tenir sa place. Dans les tracts diffusés dans la partie sud du Viêt-nam, tout ce qui aurait pu inquiéter les gens sur leur avenir religieux était soigneusement gommé.
L’image de Hô Chi Minh était celle du libérateur, du leader de l’indépendance vietnamienne. Au fur et à mesure qu’on montait vers le nord, l’emprise du communisme se manifestait avec force.
A Thai Nguyên, je n’étais enfermé que le soir. Dans la journée, on me laissait me mouvoir à ma guise à l’intérieur de la petite cour de 4 mètres sur 4 dont j’ai parlé il y a un instant. Je n’ai jamais désespéré même si j’ai fait un peu de dépression à un certain moment. Je jouissais d’une certaine liberté, mais je me sentais tout de même mal dans ma peau et plutôt porté à broyer des idées noires. J’en avais assez d’être en permanence surveillé, obligé de rendre compte de tous mes faits et gestes. Il me semble que si j’avais été interné dans un camp avec d’autres camarades, l’épreuve aurait été moins sévère. Étant seul, c’était à la fois plus facile et plus dur.
Un soir, j’ai vu arriver des prisonniers en provenance de Diên Bien Phu, ceux que le Viêt-minh appelait des « criminels de guerre ». Tous étaient des officiers de renseignements et des aumôniers, aussi bien catholiques que protestants d’ailleurs. Prisonnier avec d’autres, je n’éprouvais plus avec une grande acuité le sentiment d’être malheureux : nous l’étions tous, n’est-ce pas ? Comme nous partagions le même sort, notre regard sur nos vies bénéficiait de la somme des espoirs que nos cœurs recelaient. Alors, on s’entraidait, on plaisantait ensemble sur la disparition progressive de nos muscles, nous devenions curieusement une communauté de destins tendue vers la liberté dont on se disait sans cesse : elle reviendra!
Évidemment, le seul «catéchisme» autorisé sur le secteur était le marxisme; on avait droit régulièrement d’ailleurs à des « sermons » d’un nouveau genre dont le moins qu’on puisse dire est qu’ils étaient mille fois plus ennuyeux ou soporifiques que les pires homélies encaissées dans les églises. Avec ces aumôniers, j’ai vécu durant quelques mois. Quand la surveillance des geôliers se relâchait un peu, nous parlions. Les familiers des camps pourraient raconter l’enrichissement spirituel et intellectuel que furent pour eux ces moments de rencontre où l’esprit disponible peut laisser libre cours à son désir de construire et de creuser le sens de la vie et des choses.
Sans explication, nous fûmes séparés. On me joignit à un groupe de Vietnamiens qui, bien que prisonniers, travaillaient. Peu après, un certain nombre de prisonniers sont partis; je leur ai demandé de ne pas m’oublier lorsqu’ils seraient de nouveau en contact avec les autorités françaises. J’ai pu très vite constater qu’ils ne m’avaient pas laissé tomber. Après avoir été transféré du camp où j’étais vers une infirmerie dans une mine du plateau de Thai Nguyên ».
Evasion.
René Péchard : « A Thai Nguyên, nous possédions tout de même quelques renseignements. Nous savions par exemple qu’il existait à Hanoi non point une ambassade – la France en avait une à Saigon – mais une Maison dite « de France ». Mon désir était bien évidemment de trouver le moyen de pouvoir me rendre dans ces lieux qui, en réalité, s’ils n’avaient pas le statut d’ambassade, en faisaient totalement fonction. Les murs de la Maison de France franchis, je n’aurais aucun mal à me faire reconnaître et mon rapatriement s’imposerait. Pour atteindre ce but, j’ai rusé : il faut toujours être malin dans ces circonstances. Je me suis rendu à l’hôpital où j’allais souvent pour opérer des extractions dentaires. J’y ai rencontré un nouveau médecin qui ne me connaissait pas et je lui ai déclaré que j’avais terriblement mal aux dents. L’argument n’était pas difficile à défendre : la nourriture insuffisante et mal équilibrée, un état de santé précaire avaient rendu ma dentition plus qu’en mauvais état.
– « Écoutez, me répondit le jeune médecin, nous n’avons rien pour vous soignez. La seule chose que je puisse faire pour vous, c’est l’extraction…
–
– Pas question! Cette dent a de l’arthrite et l’extraire me créerait d’autres problèmes.
–
– De l’arthrite! s’exclama le médecin. Vous semblez bien renseigné. Ah! mais oui, vous êtes certainement le Français dont on m’a parlé et qui fait office de dentiste dans notre hôpital!
– Oui, c’est moi.
– Je ne peux rien pour vous…
– Bien sûr que non, je le sais. Vous pouvez néanmoins me rendre le service de m’envoyer à Hanoi. Là, on me soignera.
– Mais la Sécurité ne vous laissera jamais faire le voyage.
– La Sécurité, je la connais, ne vous inquiétez pas. Je vous demande simplement un papier rédigé par vos soins dans lequel vous déclarerez que mon cas requiert une intervention à Hanoi…
– Pas de problème, je vais vous le faire, ce papier mais, vous verrez, il ne vous servira à rien.
Inutile de vous dire que j’avais soigneusement préparé mon coup. J’ai attendu l’heure où le médecin-chef partait faire sa visite aux malades. Je suis entré dans son bureau où se trouvaient des secrétaires. J’ai posé la question :
– « Le médecin-chef n’est pas là ?
– Non, me fut-il répondu.
– Ça ne fait rien »
Et, avant que les jeunes filles aient eu le temps d’esquisser un geste, je pris le tampon que j’avais repéré sur le bureau et l’apposai sur mon document. Puis, sûr de moi, je quittai la pièce. Je me suis ensuite rendu chez des amis et j’ai demandé au garçon de la maison d’aller acheter un billet de bus pour la capitale. Je lui avais aussi confié mon sac. Selon mes instructions, il le mit au fond du car : à cet endroit était assis un vieux monsieur à la barbichette blanche. Je suis allé me placer au premier stop après l’aire de départ du véhicule avec, comme prétexte de mon absence, un sandwich à la main. En me portant au milieu de la route, j’ai levé le bras et le chauffeur s’est arrêté. Je lui dis :
– «Alors, vous partez sans moi?
– Vous avez un billet?
– Bien sûr que j’en ai un…
– Et le contrôle de police?
– Aucun problème, j’étais là… Regardez mon sac au fond, à côté du vieux monsieur… »
Convaincu, le chauffeur m’a laissé monter, mais dans ce pays où la paperasse administrative est devenue reine, comme dans tous les pays marxistes, un individu non muni de tous les papiers ou documents requis demeure suspect. J’ai subi deux ou trois contrôles sans ennui. Arrivé au pont Doumer, un point névralgique, je me suis mis à l’écart en me mettant à boire ostensiblement une bouteille de bière. Du coin de l’œil, je vis le chauffeur s’approcher des sentinelles de la Sécurité et me montrer du doigt. Les policiers se sont approchés et m’ont demandé mes papiers, y compris bien sûr le certificat médical.
« Mais où est donc le papier de la Sûreté ? »
J’ai alors bluffé au maximum en affirmant avec une force de conviction à la mesure de ma peur :
– « Mais je n’ai jamais eu de papier de la police pour me rendre à Hanoi!
– Vous vous rendez souvent dans la capitale?
– Bien sûr, chaque mois : je suis chargé d’y chercher des médicaments pour les camarades là-haut. »
Alors, sans leur laisser le temps de réfléchir, je me mis à les abreuver de mots sur la différence de vie entre Hanoi et la montagne :
– -« Vous avez de la chance : ici, on peut boire de la bière et la vie est moins désagréable. Là-haut, rien n’a changé : c’est comme durant la Résistance. A chacun de mes voyages, je ramène quelques bouteilles de bière pour les camarades. On se partage cela à plusieurs. Ça n’en fait pas beaucoup pour chacun, mais un fond de verre, c’est déjà mieux que rien, n’est-ce pas, camarades « ? ».
J’ai réussi, je crois, à endormir complètement leurs soupçons; ils m’ont laissé passer. Arrivé à Hanoi, j’étais bien évidemment habillé avec l’uniforme viêt-minh. Mes sandales « Hô Chi Minh », fabriquées dans des pneus, avaient rendu l’âme. Je me mis donc à marcher pieds nus. Cela ne me dérangeait pas. Une femme m’aperçut et s’exclama : « Un Français qui marche sans chaussures! » Elle me fit entrer chez elle, se rendit au marché tout proche et en rapporta une paire de sabots nantis d’une semelle et d’une bride dans laquelle on passe les orteils. À dire vrai, ces sabots particuliers me rendirent la marche bien plus difficile que les pieds nus, mais le geste me toucha profondément. En questionnant discrètement les gens de la rue, j’arrivai dans ce que je pris pour le centre ville. Je n’osai pas demander directement le chemin de la Maison de France, de peur de me faire suspecter puis « mettre à l’ombre ». Je repérai un Blanc. Nous marchions un moment côte à côte, nous dévisageant avec méfiance. Je finis par lui dire :
– « Vous êtes français ?
– Oui, et vous?
– Moi aussi… Mais qu’est-ce que vous fichez dans cette défroque ? »
Je lui expliquai que je m’étais évadé et que je voulais me rendre à la Maison de France.
– -« On ne peut pas parler librement ici. D’autre part, jamais vous ne rentrerez dans cette tenue à la Maison de France. Les sentinelles viêt-minh vous arrêteraient à la porte. Venez avec moi… mais restez à dix pas derrière. »
Son attitude était compréhensible. Les quelques Français qui restaient à Hanoi étaient méfiants, et donc prudents. Je suivis l’homme et arrivai dans un hôtel où résidaient seulement des Européens. Il y avait là des pilotes qui s’occupaient de la Commission internationale de contrôle, ainsi que quelques journalistes et commerçants tolérés par le régime. J’ai raconté mon odyssée et, en quelques minutes, je me suis vu habillé de pied en cap et cravaté. A cinq dans une voiture, nous partîmes vers la Maison de France. La sentinelle, voyant des Européens dans le véhicule, nous laissa passer sans aucun contrôle. Par un hasard extraordinaire, le consul, tout de suite rencontré, me dit : « Vous tombez à pic… Nous avons reçu un dossier vous réclamant! »C’étaient les militaires avec lesquels j’avais passé quelques semaines. Ils ne m’avaient pas oublié. Ces soldats, héros de Diên Bien Phu, avaient signalé ma présence afin que l’on puisse me récupérer. La réclamation arrivée, l’enquête effectuée, j’ai pu avoir tout de suite un passeport français. Les vêtements qui m’avaient été prêtés, on me les a donnés. Je me suis alors rendu à l’hôpital, parce qu’à l’ambassade on m’a déclaré : « Vous ne pouvez pas rester ici, mais vous ne pouvez non plus partir rapidement; votre visa va être très long à obtenir et, si vous pouviez trouver une activité à Hanoi, ce serait bien… »Je suis allé à l’hôpital pour m’y faire soigner les dents. Après avoir reçu les soins dont j’avais besoin, j’ai demandé un rendez-vous au médecin-chef et lui ai expliqué ma situation. Très vite convaincu que je pourrais lui rendre service, il m’affirma qu’on pourrait sans difficulté me confier des activités touchant à l’art dentaire. Il faudrait pour cela avoir l’accord du ministère.Son travail terminé, nous nous rendîmes ensemble au ministère de la Santé, à bicyclette bien sûr puisqu’il m’en avait fait prêter une. On me donna un laissez-passer pour retourner à Thai Nguyên y chercher le peu d’affaires que je possédais, et surtout pour me mettre en règle. Avec le laissez-passer, mon retour à Hanoi était assuré. J’avoue que je ne suis pas retourné là-haut sans appréhension : après tout, ils avaient le droit de ne pas apprécier la façon dont j’avais pris congé… Ce fut donc dans des sentiments un peu mêlés que je me présentai devant les autorités de Thai Nguyên. Miracle de l’administration et des tampons officiels : on m’accueillit sans faire même allusion à ma « fuite » en catimini. Tout fut réglé en quelques heures et mon retour à Hanoi se passa sans encombre. Je me suis tout de suite mis au travail et j’ai attendu que mon visa arrive.II y avait encore un prêtre français que l’on n’avait pas expulsé. Je passais chez lui presque tous les soirs. Je sentais nécessaire d’être en rapport avec cet homme de Dieu qui était mon lien privilégié avec l’extérieur. Il me passait des journaux qu’il recevait par l’intermédiaire de l’ambassade. Ainsi avais-je la possibilité de me désintoxiquer. On ne peut impunément vivre durant sept ans le crâne bourré par le même type de discours, mouliné régulièrement dans des stéréotypes dont le vide apparaît très vite mais qui peu à peu s’impose mécaniquement comme le seul possible, puisque la confrontation avec d’autres idées devient matériellement impensable. C’est un peu comme la goutte d’eau qui tombe et creuse progressivement son trou. A la fin, on ne peut plus penser que d’une seule manière. En réalité, on n’a même plus le droit de penser. Face à de telles contraintes dont je sentais qu’elles me dépersonnalisaient progressivement, l’existence du père français a été décisive : il fut ce havre de liberté ou d’indépendance d’esprit grâce auquel j’ai pu conserver intacte une grande partie de moi-même… Mon anti-lavage de cerveau! L’image de Hô Chi Minh était celle du libérateur, du leader de l’indépendance vietnamienne. Au fur et à mesure qu’on montait vers le nord, l’emprise du communisme se manifestait avec force.Certes, les chrétiens continuaient à pouvoir aller à l’église, mais ceux qui le faisaient étaient fichés. Je me souviens qu’à Hanoi même, lorsque j’étais surveillé mais libre de mes mouvements, les gens chez lesquels j’habitais n’adhéraient absolument pas au communisme. Tout près de chez eux, l’un de leurs voisins pratiquait régulièrement. Il n’avait pas peur de montrer ses convictions, mais se savait contrôlé dans chacun de ses va-et-vient. On lui demandait de participer chaque semaine à de nombreux « carrefours » d’information politique. Un jour, il m’a avoué : « Soyez gentil, ne venez plus me rendre visite. Après chacun de vos passages, on vient me demander l’objet de nos conversations, ce que vous avez raconté, ce que vous projetez de faire, la nature de vos intentions… ».[4]
*
JCD : René Péchard est alors âgé de quarante deux ans. Arrivé à Hanoi en mars 1955, il n’en repart que le 20 septembre 1956. Une ambiance un peu surréaliste s’étend sur la ville. Les vainqueurs multiplient les manifestations populaires alors que les camps, tout juste vidés des derniers Français, se remplissent d’“ennemis de classe ” – vietnamiens cette fois-ci.
Je ne suis qu’un lycéen de quinze ans qui lit les gros titres des journaux sans trop comprendre le drame qui se joue à quelque dix mille kilomètres. Je m’enthousiasme pour les héros de l’armée française. Le monde est partagé entre les bons et les méchants. Je ne peux savoir que mon chemin croisera beaucoup plus tard celui de René Péchard.
*
R.P. : « J’ai tout de même dû attendre dix-huit mois un visa de sortie. Dans un premier temps, je l’ai obtenu au bout d’un an. La veille du départ, il me fut retiré provisoirement parce que, m’a-t-on dit, il fallait que « la république démocratique du Viêt-nam » et moi-même «nous nous connaissions mieux, que je puisse dire au peuple de France tout l’amour du peuple vietnamien, que je puisse décrire en détail les nombreuses réalisations du Parti… », et plein de belles choses de ce genre. J’ai participé deux fois par semaine à des cours d’éducation politique; je ne pouvais faire autrement : le visa était au bout. Six mois plus tard, je l’ai enfin reçu, ce précieux document.
Lorsque, la veille au soir, le fonctionnaire que j’avais rencontré lors de mon premier départ avorté frappa à ma porte pour me dire « Vous partirez demain », s’il m’avait enjoint de le suivre, je ne sais pas ce que j’aurais fait : je tremblais en le voyant s’approcher de moi. A sa phrase, j’ai répondu « oui » d’une voix presque absente. Alors, l’homme ajouta : « Mes camarades m’ont prié d’être leur interprète pour vous souhaiter bon voyage. Nous espérons que vous n’oublierez jamais ce que vous avez appris en république démocratique du Viêt-nam ».
« Vous pouvez être sûr que non », ai-je rétorqué avec la plus éclatante des sincérités… Mais sans doute le camarade du Parti n’a-t-il pas perçu l’ironie de mon affirmation enthousiaste. Pensez : j’avais vu des pauvres gens de soixante-dix à soixante-quinze ans, arrêtés à cause de leurs opinions. J’avais, en me cachant (car cela m’était interdit), assisté à des « tribunaux du peuple » où des vieillards agenouillés, aux trois quarts nus, se faisaient insulter par la foule, cracher au visage et condamner à mort. Je pouvais donc faire sans problème la promesse sincère que je n’oublierais jamais… Cela est tellement vrai qu’aujourd’hui encore ces scènes me sont aussi présentes qu’au premier jour. Le vieillard que je suis devenu n’a en tout cas pas perdu la mémoire de ces faits, de ces attitudes. Vous conviendrez qu’il y avait de quoi marquer un homme. »
JCD : Scènes saisissantes qui en rappellent ou en annoncent d’autres. L’opportunité de s’attribuer sans frais un coin de rizière ou une position sociale, la peur aussi, la jalousie parfois… voilà qui rassemblait ces foules vociférantes !…. Les périodes troublées, révèlent autant les hommes et femmes de cœur et de courage qu’elles suscitent la revanche des médiocres et des lâches. Les idéologies utilisent à leur profit les sentiments nobles ou pervers qui agitent le cœur de l’homme et qui s’alimentent dans ces zones d’ombre et de lumière qui échappent parfois à sa volonté.
René Péchard restera toute sa vie marqué par une expérience qu’il ne pouvait partager. Moi-même, qui l’aimais, le respectais, l’admirais, je ne compris cela que plus tard.
R.P. : « La Commission internationale de contrôle du cessez-le-feu, la C.I.C avait pour mission de contrôler l’arrêt des hostilités à la fin de la guerre du Viêt-nam, version française. Il n’était bien sûr pas encore question d’une intervention américaine. Non, la Commission devait tenter de régler les différends entre le Nord et le Sud Viêt Nam, entre le Pathet Lao et le gouvernement royal du Laos. Même travail au Cambodge. Quatorze-pays, me semble-t-il, faisaient partie de cette Commission, mais trois seulement étaient actifs sur place et avaient leur délégation permanente : les Polonais, les Indiens et les Canadiens. Un avion français faisait régulièrement la navette entre Hanoi, Vientiane, Phnom Penh et Saigon, et c’est par l’un de ces avions que j’ai quitté Hanoi. A côté de moi était assis l’attaché culturel de l’ambassade de France à Hanoi. Je tournais constamment la tête vers les portes de sortie de l’avion… Sur la passerelle se tenait un policier. L’attaché culturel, me voyant manifestement mal à l’aise, finit par me dire : « Mais qu’avez-vous donc ? Vous transpirez la peur! » Je lui répondis : « Oui, j’ai peur, et tant que nous n’aurons pas franchi l’espace aérien vietnamien, je crois que ma peur restera entière. » L’avion a décollé. Deux heures plus tard, je débarquais à Vientiane au Laos. C’était le 20 septembre 1956 à dix heures du matin, un jour et une heure qui demeureront gravés à jamais dans ma mémoire.
D’autres Français qui n’ont pas eu ma chance ont été « oubliés » à ce moment-là et je suis persuadé que plusieurs compatriotes se trouvent encore là-bas : peut-être s’y sont-ils mariés. En arrivant au Laos, je pensais, j’espérais que les Laotiens avaient moins souffert que les Vietnamiens. Je me suis bien vite aperçu qu’il en était de même. J’ai débarqué seul et sans projet, pensant ne rester à Vientiane qu’une quinzaine de jours, une espèce d’étape avant mon retour vers la France.
[1] Il était né le 2 avril 1912 à Trévoux.
[2] « A la veille de vos prochains combats, je suis heureux de savoir que vous n’oubliez pas que vous détenez une part de notre honneur militaire… c’est votre pays que vous protégez ainsi… ». Déclaration signée du maréchal Pétain
[3] Fondateur du Parti Populaire Français.
[4] Voir l’ouvrage « Piété Filiale » pour de nombreux et fort témoignages sur cette période.