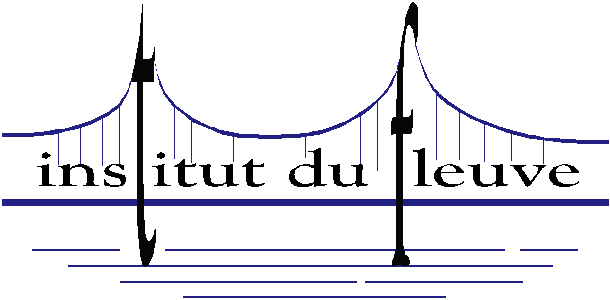Les camps de réfugiés en Thaïlande
ouvrage disponible aux éditions du Jubilé)
René Péchard : « L’urgence, cependant, était les camps de Thaïlande. J’y fis, en 1975, le tour des communautés laotienne et cambodgienne. Je ne connaissais pas encore les Cambodgiens ; ce n’est qu’à mon voyage suivant que je me suis rapproché d’eux. A l’intérieur du camp, il m’a été donné de reprendre contact avec de nombreux anciens de nos foyers, et avec également pas mal de jeunes qui n’avaient pas fait appel à nous au Laos parce que leurs parents disposaient des biens nécessaires pour leur permettre une vie et une éducation normales. Tous ces gens se retrouvaient au même point de détresse et de pauvreté. Simplement, les plus pauvres en souffraient moins, habitués qu’ils avaient été de disposer de peu dès leur enfance. Les enfants de paysans côtoyaient les fils de ministres et de généraux. S’ils n’étaient pas partis avec de l’or ou une poignée de dollars, ils se trouvaient dans le même dénuement matériel! Tous avaient eu de bonnes raisons de quitter le pays où la « rééducation » avait commencé… Pour des raisons humanitaires évidentes et parce que tout le système scolaire cambodgien et laotien était de « type français », j’eus la possibilité de faire rapatrier vers la France de nombreux jeunes en cours d’études. Il était vital pour eux de ne pas perdre trop de temps : le gouvernement français le comprit et n’hésita pas à leur donner les visas nécessaires. Nous n’étions heureusement pas les seuls à nous occuper de ce drame des réfugiés du Sud-Est asiatique. Je le vis très bien au nombre des demandes qui me furent faites à mon retour à Paris en décembre 1975. Il y avait évidemment nos anciens à nous, mais aussi de nombreux jeunes qui se trouvaient démunis, avec en poche seulement leur visa de séjour. Je vis qu’à l’évidence il fallait que je m’occupe en priorité du sort des jeunes Asiatiques sur le territoire français, sans pour autant abandonner les camps de réfugiés …
… Il convient peut-être de se remémorer ce qu’a été, ce qu’est encore l’exode des réfugiés de cette région du monde… Comment ces hommes, ces femmes, ces enfants ont-ils quitté leur pays, leur famille, leur environnement culturel pour arriver en Malaisie, en Thaïlande et, ensuite, dans le pays du troisième accueil pour certains?
En ce qui concerne le Laos, la plupart des évasions se sont opérées à travers le Mékong. Les gens sont arrivés en grand nombre dans le camp de Nong Khai situé en Thaïlande, au bord du fleuve, à une vingtaine de kilomètres au sud de Vientiane. A cet endroit, la Thaïlande et le Laos se touchent pratiquement et il y a des endroits où le fleuve n’est pas large et pas trop profond. Au début, les évasions étaient relativement aisées. On demandait un laissez-passer aux autorités locales pour aller voir un malade ou visiter des amis du côté thaïlandais… et on ne revenait pas! Par la suite, la frontière a été hermétiquement fermée et les passages sont devenus hasardeux, sinon mortels. Beaucoup ont été tués par des patrouilles en tentant de traverser le Mékong à la nage ou sur des embarcations de fortune.
A l’occasion de cet exode, une nouvelle profession est née : celle de passeur professionnel. Cela coûtait très cher de s’offrir cette « promenade ». Une somme rondelette réglait d’abord les services du batelier, mais il fallait également « arroser » les gardes du Pathet Lao et les policiers thaïs. Beaucoup de familles y ont laissé tout leur avoir, sans parler des aventures arrivées à certains qui ont payé rubis sur l’ongle et qui se sont retrouvés en prison ou en camp de rééducation au Laos, trahis et vendus par les passeurs eux-mêmes… Pour ceux qui n’avaient pas d’argent – les plus nombreux, bien sûr -, la seule solution était le passage à la nage ou en pirogue. Je pense à ce qu’a tenté le beau-frère de l’un de nos pupilles au Laos. Après son arrestation, il découvre que l’un de ses gardiens fait partie de ses anciens amis. Ce dernier est embrigadé dans la police, car il ne peut faire autrement. Il lui est demandé d’avertir la femme du prisonnier avant qu’elle ne soit arrêtée, de manière qu’elle puisse fuir avec son bébé. Le gardien fait la commission. La jeune femme se rend chez son frère, notre ancien pensionnaire. Ils vont ensemble au bord du Mékong et construisent un radeau de fortune avec les débris nombreux qui jalonnent les berges du fleuve. Sur cette embarcation, ils attachent le bébé qu’ils avaient préalablement enfermé dans un sac en plastique avec seulement une petite ouverture pour que l’enfant puisse respirer. Ainsi, en nageant et en poussant le radeau, ils arrivèrent du côté thaïlandais sains et saufs…
Une autre histoire vécue : une famille – le père, la mère, trois frères et deux sœurs – tente la traversée du Mékong avec un passeur. Une première barque est partie : on attend en vain son retour. La famille monte sur une autre embarcation qu’elle ne connaît pas. Le bateau, à moitié pourri, coule à cent mètres environ de la Thaïlande. Les garçons, qui savent nager, rejoignent la berge; leur père, leur mère et leurs deux sœurs se noient sous leurs yeux…
Ces deux exemples sont largement suffisants pour montrer le calvaire de ces pauvres gens. Que de morts, que d’arrestations, que de souffrances endurées pour recouvrer la liberté… »
Le Cambodge a vécu également un exode tragique qui, malheureusement, continue plus que jamais. Les Khmers rouges avaient semé des mines sur toute la frontière pour endiguer le flot des réfugiés. Personne n’a encore pu dénombrer les morts dans cette région: ils se comptent vraisemblablement par centaines de milliers et s’ajoutent au million et demi de victimes de l’un des génocides les plus atroces de l’Histoire. Très vite, il y a eu aussi les blessés par mutilation, car le drame de la guerre marque par fois jusqu’à la fin ces pauvres êtres qui n’ont pas su voir qu’à l’endroit où ils posaient le pied sommeillait un engin de mort…
Au camp de Khao-I-Dang, nous avons vu travailler les praticiens de « Médecins sans Frontières »… Que de dévouement et d’abnégation chez ces médecins, hommes et femmes venus de France ! Ils ont effectué des dizaines de milliers d’amputations dans des conditions de travail plus que précaires. A la suite de ces drames, Jean-Baptiste Richardier, un jeune médecin, a fondé « Opération handicap internationale », une nouvelle association plus spécialisée, comme son nom l’indique. Avec ses amis, il a fabriqué des prothèses toutes simples qui pouvaient être entretenues sur place et renouvelées s’il en était besoin. Cela pour permettre aux gens qui éventuellement retourneraient dans un Cambodge démuni d’avoir une réelle autonomie à l’aide de petits moyens. Évidemment, les réfugiés ainsi appareillés ne gardaient pas ces prothèses sommaires quand, entrant dans un nouveau pays, on pouvait leur proposer autre chose. Mais dans les camps, ces prothèses même rudimentaires leur ont permis et leur permettent encore une relative motricité et la satisfaction de ne pas être uniquement un fardeau pour leur communauté .
Récemment encore, 250 000 Cambodgiens, chassés par la guerre qui sévit chez eux et qui oppose le Cambodge aux soldats vietnamiens communistes, ont obtenu l’autorisation de s’installer à l’intérieur de la Thaïlande. Ils sont à cinq ou six kilomètres au maximum de la frontière. Les gens qui se trouvaient pratiquement sur la ligne de séparation entre les deux pays ont dû prendre la fuite en quelques minutes sous les bombardements. J’ai vu des jeunes gens et des jeunes filles sans même un vêtement pour se couvrir. Avec leur famille, ils ont tout laissé sur place et nous avons dû leur procurer les choses les plus élémentaires pour survivre. D’autres organisations humanitaires, mieux équipées que nous, ont pris le relais et je crois que la situation est devenue moins catastrophique, mais elle demeure cruciale parce que, encore une fois, la Thaïlande ne peut se permettre de nourrir un surcroît de population aussi considérable. Il incombe donc à l’aide internationale de prendre le relais – ce qui se fait, mais avec toutes les lenteurs et les pesanteurs administratives. Si j’avais quelque pouvoir, je préconiserais l’institution d’une vraie « cellule de crise » jouissant, au niveau mondial, d’une autonomie d’action et de moyens, grâce auxquels il serait possible d’intervenir vite et fort en cas de conflit ou de catastrophe naturelle…
On nous signale en permanence des morts ou de grands blessés, à la frontière du Cambodge surtout. Parce que les mines coûtent cher, les gardes frontières communistes les ont remplacées par de véritables pièges à animaux. Ils creusent des fosses qu’ils garnissent de bambous acérés qui tailladent les chairs et mutilent affreusement. Aujourd’hui encore, devant une opinion internationale lâche et indifférente, des enfants agonisent pendant des heures, empalés sur des pieux… »
Même si les grands moyens de communication ne parlent presque plus des réfugiés du Sud-Est asiatique, il faut savoir que l’exode continue[1] et qu’il s’est intensifié depuis quelques mois. Il y a eu, c’est vrai, une année d’accalmie qui a correspondu, notamment au Viêt-nam, à une certaine « libéralisation » du régime en matière d’émigration. Beaucoup de gens ont pu quitter le pays légalement. Puis, on ne sait pourquoi, les difficultés se sont récemment accumulées sur la tête des gens qui désiraient partir. On les a noyés sous des flots de papiers, de documents divers. Alors, découragés par les «listes d’attente », ils ont choisi de partir à nouveau clandestinement. Il ne faut pas être dupes : silence dans les médias ne signifie pas absence de problème. Le meilleur exemple que je puisse donner est le cas de l’Irlande du Nord. Les bombes et les assassinats n’ont jamais cessé depuis trente ans… Simplement, on n’en parle que lorsque les victimes sont nombreuses et l’attentat spectaculaire.
Pour les Vietnamiens, dès le début, l’exode fut plus tragique encore. Certains, avec de petites embarcations, ont suivi la côte vietnamienne à distance pour ne pas être repérés. Ils ont pu ainsi arriver dans les parages de Liemg Sing. Là s’est établi l’un des premiers camps de boat people. D’autres, sur des bateaux plus importants et souvent surchargés, sont arrivés sur la côte sud de la Thaïlande, particulièrement aux environs de Jong La. Cet exode est déjà en soi très dangereux, mais les pirates du secteur y ont vu une excellente occasion de s’enrichir en volant, violant, taillant en pièces ces pauvres gens. Combien de morts là aussi, combien de bateaux dont les passagers ont été dépossédés de tout, les jeunes femmes et les jeunes filles violentées et souillées sous les yeux pétrifiés des enfants ! On ne le dira jamais assez : les réactions internationales ont été bien légères face à ces actes de banditisme, ces assassinats et ces viols. Vous connaissez bien sûr le fameux principe de « non-ingérence dans les affaires intérieures d’un pays »… C’est probablement l’attitude la plus hypocrite qui ait jamais été inventée. Elle permet de garder des relations quasi normales avec des pouvoirs assassins et, bien évidemment, on la considère comme nulle et non avenue lorsque les intérêts nationaux rendent une intervention intéressante ou utile. S’occuper des pauvres et des réfugiés, c’est faire quotidiennement l’expérience de l’égoïsme des États et, partant, des collectivités qui moralement ne fonctionnent que par intérêt. La générosité, qui existe partout, est le fruit d’une démarche individuelle motivée la plupart du temps par la foi ou les idéologies. Qu’on ne me fasse pas dire ce que je n’ai pas dit. Il y a parfois des fonctionnaires ou des diplomates ouverts aux problèmes humains et qui vibrent aux conditions dramatiques de ces « abandonnés de la terre » que sont les réfugiés. Mais ils avouent eux-mêmes être limités dans leur action par des instructions gouvernementales sèches et draconiennes. Les crises successives du Marché commun agricole nous ont habitués à des expressions devenues des lieux communs, comme «quotas laitiers». Eh bien! sait-on qu’en matière d’immigration on parle aussi de « quotas humains »?… Mettre l’homme en quota, quelle injure faite à sa dignité!
Heureusement qu’existent des initiatives privées, qui sont en fait la gloire de notre civilisation occidentale trop intéressée par son bien-être et sa qualité de vie…Je pense à Bernard Kouchner et à son idée de Ville-de-Lumière, le bateau qu’il a affrété pour recueillir les malheureux boat people. Avec ce navire, il a croisé dans le golfe du Siam en mer de Chine, et nombreux sont ceux qui ont échappé à la mort grâce à son aide et à celle de ses collaborateurs. Malheureusement, faute de moyens, l’expérience a dû temporairement être interrompue. Aujourd’hui, un autre navire escorté par la Marine nationale continue à recueillir des naufragés, mais l’opération coûte cher : cela pourra-t-il durer ? Peut-on vraiment chiffrer la vie d’un homme ou d’un enfant que l’on sauve ?
Jean-Claude Didelot. « Bernard Kouchner devait venir nous rendre visite à Asniéres peu de temps après la mort de René Péchard. Il se montra fraternel et exigeant avec les jeunes qui, sachant qui il était, lui firent fête.
« Peut-on vraiment chiffrer la vie d’un homme ou d’un enfant que l’on sauve ? ». Dans la bouche de « Tonton », ceci n’a rien moins d’une phrase convenue, d’une incantation pieuse. Je ne l’ai jamais vu prendre l’argent comme critère ni dans le choix de ses collaborateurs, ni dans celui des besoins. L’argent est au service des détresses, pas l’inverse ».
René Péchard : « Malgré les mines, les noyades et les meurtres, de nombreux réfugiés sont arrivés à passer la frontière. Ce qui les attendait de l’autre côté n’était pas la liberté, mais bel et bien les barbelés et les camps. Je sais qu’on a jugé sévèrement à l’étranger l’attitude du gouvernement thaï. Il reste que ce pays a au moins accepté l’arrivée sur son territoire de cette marée humaine, ce que beaucoup d’autres pays ont refusé. On a souvent passé sous silence que des bateaux de boat people ont été accueillis à coups de mitrailleuse et de canon, lorsqu’ils tentaient d’aborder sur les rives de certains pays du Sud-Est asiatique… La Thaïlande a ses problèmes humains et économiques. Elle a donc du mal à affronter sans difficulté les centaines de milliers de réfugiés dont les camps ponctuent son territoire du nord au sud et de l’est à l’ouest. Je connais les Thaïlandais et leur proverbiale générosité. J’aurais mauvaise grâce à les juger. Ceux qui sont condamnables, en revanche, ce sont les gouvernements qui refusent d’ouvrir leurs portes à ces pauvres gens des camps. Si nous étions nous-mêmes dans une situation analogue, si nous voyions dépérir nos enfants derrière des barbelés, que penserions-nous des nations qui refuseraient de nous donner une chance de vivre ? Il est faux de dire que la France et les pays européens ne peuvent plus ouvrir leurs frontières. Malgré les difficultés économiques, notre pays s’enorgueillit de participer à des conférences dont certaines réunissent les pays les plus riches du monde. L’aveu est de taille… Nous sommes riches, et donc aptes à aider. Il faut que nous le fassions, et avec générosité. Comment pourrions-nous oublier que le Laos, le Cambodge et le Viêt-nam ont été pendant plus d’un siècle partie intégrante des possessions françaises?
Nous avons exploité leurs richesses à notre profit et bien des fortunes françaises se sont ainsi réalisées. Beaucoup de réfugiés ont refusé le régime qui est devenu celui de leur pays, justement parce qu’à nos côtés ils s’étaient pénétrés d’un idéal de démocratie et de liberté. Il faut les aider à concrétiser la découverte de la légitime indépendance de l’esprit et des actes humains, à laquelle nous les avons sensibilisés. Pour ce faire, menons un double combat : d’abord celui qui consistera à se battre contre les égoïsmes individuels, ensuite celui qui aura pour but de mettre les États face à leurs responsabilités. Je ne suis pas naïf, en tout cas pas complètement : la lutte sera d’autant plus rude que le drame des réfugiés du Sud-Est asiatique est l’un des problèmes cruciaux de notre monde, qui en connaît des centaines. Mais pour nous, cette partie du monde charrie tellement de souvenirs que nous ne saurions abandonner à leur sort tragique tous ces gens qui pendant longtemps ont été les compagnons de route de notre nation.
Dès 1975, me trouvant en Thaïlande, j’ai appris la création à l’ambassade de France d’un Comité d’entraide franco-vietnamien, franco-laotien et franco-cambodgien. Je fus l’un des premiers à adresser aux instances diplomatiques du pays un rapport sur les camps que j’ai pu visiter. Jusqu’à ce jour, les réfugiés qui partaient devaient acquitter le prix de leur billet d’avion : le visa d’entrée en France leur était donné par le consul. Souvent, certains sont partis munis d’un simple visa de tourisme qui était transformé en visa de séjour dès leur arrivée et leur installation sur le territoire national.
*
Jean-Claude Didelot : « Le général de Division Guy Simon, qui s’était illustré en sauvant son commando Français d’Extrême Orient dans des conditions rocambolesques[2], fut le dernier président du Comité. Il s’y dévoua sans compter avant de devenir président National de l’Association des Anciens et Amis d’Indochine. Un jour, il m’apporta un petit brûle parfum ancien :
– « C’est un souvenir de mon grand-père qui avait fait campagne au Tonkin. Je ne sais pourquoi, j’ai décidé de vous le donner…. Tout comme le parfum, il faut être prêt à être consumé.
Il toussota :
– Je ne sais pas trop pourquoi je vous dis tout cela ! »
Ami fidèle, il devait devenir administrateur de l’Association jusqu’à sa démission, avec six autres administrateurs en 2001 lorsqu’il jugea qu’il n’y avait plus sa place après mon départ ».
*
René Péchard : « Tout s’est organisé assez rapidement. Le Comité national d’entraide a reçu du personnel détaché de plusieurs ministères, ainsi que des subventions. Rendue d’une certaine manière autonome, la nouvelle structure s’est acquis des employés pour elle-même et a envoyé sa première commission d’enquête en Thaïlande. Cette commission était composée de trois officiers et de plusieurs secrétaires, sous-officiers de l’armée. Elle a toujours admirablement fonctionné. Il est clair que ces hommes et ces femmes sont allés bien vite au-delà de leurs prérogatives administratives. Ils ont rencontré un problème humain poignant et, plus qu’en fonctionnaires, ils ont réagi en êtres humains sensibles à la pitié. La commission a eu dès l’origine un rôle précis : procéder à la « sélection » des réfugiés que l’on allait accueillir en France. Le terme de « sélection » est dramatique en lui-même lorsqu’on l’applique à des êtres dans le dénuement. Au nom de quels principes peut-on décider que tel homme doit être choisi plutôt que telle femme ou que tel enfant handicapé ou malade ? Parce qu’il fallait de toute façon opérer des choix, la commission s’est tournée en priorité vers les veuves seules avec leurs enfants, les amputés, les handicapés de toute sorte… Mais beaucoup d’autres ont été aussi sélectionnés.
Les choix sont toujours critiquables et soumis à l’erreur. Mais, encore une fois, choisir a été souvent à la fois dramatique et nécessaire, et il serait injuste et malvenu d’éreinter des organismes et des hommes qui, au fond, ont loyalement tenté d’apporter une solution à un problème humain particulièrement aigu et dramatique… En fait, l’aide internationale, et notamment française, a la curieuse habitude de suivre le caractère pointu des questions en suspens. Quand les boat people et plus globalement les réfugiés du Sud-Est asiatique ont défrayé la chronique et que des images choc sont arrivées sur les « petits écrans » et sur les couvertures des grands magazines, les frontières françaises se sont ouvertes pour plus de 1500 réfugiés chaque mois. Très vite, le chiffre est tombé à 700. La moyenne depuis janvier 1985 est d’environ 200 personnes par mois, mais on a vu des périodes où une famille ou deux seulement pouvaient entrer dans le pays. C’est bien peu pour la France dont on sait les liens privilégiés tissés par elle avec cette partie du monde. Resserrement budgétaire ou lassitude face à un drame qui a l’incongruité de se perpétuer, la commission d’enquête se réduit aujourd’hui à un unique officier en poste à l’ambassade de France à Bangkok. A cet homme seul incombe la visite de tous les camps qui jalonnent le sol thaïlandais. Pourquoi une telle attitude?
En 1981, dans les camps cambodgiens, combien de fois n’avons-nous pas entendu des phrases du type : « Nous sommes des enfants de la France, nous avons fait toutes nos études en France; ce que nous sommes, c’est à la France que nous le devons. Nous regrettons beaucoup que la France soit si peu présente ici à nos côtés. »
Les gens qui s’exprimaient ainsi n’étaient pas « internés » à proprement parler. On les avait regroupés dans des « sites », c’est-à-dire des endroits situés à quelques kilomètres de la frontière cambodgienne où ils attendaient des jours moins terribles pour retourner au Cambodge. A la vérité, nous sommes si peu présents au Cambodge que, dans ce pays qui fut très globalement francophone, la langue française est complètement abandonnée. Comme partout dans cette région du monde, l’anglais devient le mode d’expression majoritaire, non point parce que les autochtones le souhaitent vraiment, mais parce que les pays anglophones agissent en des endroits abandonnés de fait par la francophonie. Le phénomène est loin d’être circonscrit à l’Asie. Des amis proches qui travaillent au Moyen-Orient font le même type de constatation : le recul de l’influence culturelle française est sensible partout, faute d’investissement en hommes et en moyens matériels. Que dire, sinon un immense «dommage!», car avec notre culture disparaissent aussi les valeurs qui nous sont propres et qui nous permettaient de continuer la mission spécifique de la France au cœur du monde moderne…
Des initiatives privées viennent tout de même tempérer un jugement qui pourrait être globalement négatif. Dans plusieurs camps de Thaïlande, une association comme « École sans frontières», dirigée par le docteur Nguyên Phat, son président fondateur, organise l’enseignement du français. Cette action pourrait très bien, si de vrais moyens lui étaient donnés, s’étendre aux « sites » que j’ai évoqués tout à l’heure. Rien n’est plus émouvant que devoir ces jeunes, enfermés depuis trois, cinq et parfois six ans derrière des barbelés, qui, lorsque vous leur rendez visite, n’ont de cesse que de vous montrer qu’ils s’expriment correctement en français. Diverses congrégations religieuses, notamment les Missions étrangères de Paris, et des instituts féminins travaillent avec ténacité pour, à la fois, promouvoir la langue française et assurer la possibilité d’une information ainsi que d’une formation spirituelles dans les camps et dans les sites.
*
Jean-Claude Didelot : « René Péchard était très attaché à la défense de la francophonie. Il n’en faisait ni une priorité ni une condition mais nous pensions qu’il y avait là un devoir et un service. En 1997, le Haut Conseil à la Francophonie me demanda un article pour préciser notre pensée ».
(Voir « Piété Filiale », chapitre 5)
*
René Péchard : « Le dévouement désintéressé de beaucoup d’organisations protestantes comme « Inter-Aide », dont le siège est situé à Strasbourg et que dirige André Gasser, contribue à faire que la France est tout de même présente dans le Sud-Est asiatique. Mais, encore une fois, l’action est de type privé et peut-être les pouvoirs publics se contentent ils de cet état de fait pour limiter de plus en plus leur engagement…
Nous mêmes avons vécu une notable évolution au cours de ces douze années. Au début, les réfugiés jouissaient d’une relative indépendance. Ils pouvaient assez aisément sortir des camps en demandant une autorisation. Puis, pour des raisons difficiles à cerner et qu’en tout cas j’ignore, la situation s’est durcie et certains camps se sont définitivement fermés, tel Sikhiu… Lorsque cet endroit a prioritairement accueilli des boat people, il est devenu impossible d’en sortir et, pour l’Association, impossible d’y entrer. Aujourd’hui, les ministères thaïlandais n’accordent pratiquement plus la permission de visite.
Le camp de Napho, qui reçoit majoritairement des Laotiens, est également très clos. Je n’ai jamais pu en franchir les portes. Il a donc fallu cibler autrement notre forme d’aide. Nous avons donc choisi le parrainage. Les amis intéressés par cette forme d’aide nous versent 100 ou 150 francs par mois. Nous donnons à chaque réfugié pris en charge l’équivalent de 50 francs par mois. Si l’intéressé est chargé de famille, nous allons jusqu’à cinq parrainages, soit environ 250 francs. Cette somme, qui serait dérisoire dans le contexte occidental, représente à peu près la moitié du salaire d’un petit fonctionnaire thaï et dépasse en tout cas la paie d’un ouvrier. Notre problème aujourd’hui consiste à être attentifs à ne pas créer trop de différence entre l’aide apportée aux réfugiés des camps et la situation économique objective des populations des environs. C’est ce qui a motivé notre choix de limiter à cinq les parrainages potentiels. Quelques aides ponctuelles ont pu être entreprises malgré les difficultés encourues. Je pense à notre contribution dans la mise en place d’un foyer de mineurs dans le camp vietnamien de Sikhiu. Notons aussi l’aide à la création d’une école allant de la maternelle à la troisième dans le même camp. Nous aidons également sœur Pierre-Marie qui s’occupe des lépreux à Ban Vinaï, de même que sœur Mercedes qui, elle, a pris en charge les enfants handicapés dans cet endroit qui regroupe la bagatelle de 40 000 personnes… Ces aides ponctuelles devraient être augmentées. Elles sont limitées à la fois par les autorités locales et par nos propres possibilités financières. Nous nous occupons en plus du site 2 qui, avec le site 7, compte 250 000 personnes déplacées.
Là, deux collèges existent qui ont été pris en charge par le Secours catholique thaïlandais. L’un d’entre eux a bien du mal à s’en tirer, faute de dons. Nous allons vraisemblablement prendre la décision de nous en occuper afin que tous les enfants qui le fréquentent puissent être convenablement habillés et disposer du matériel scolaire indispensable. En ce moment, les maîtres ne disposent même pas des livres nécessaires. Les enfants se partagent une pointe Bic à trois ou quatre… Quant au tableau noir, il n’est pour le moment qu’un rêve…Les instituteurs nous ont demandé des ouvrages scolaires en français, bien qu’ils enseignent en khmer, et cela pour guider leur travail pédagogique. Tous les enseignants parlent français; peut-être pourrons-nous faire accepter l’enseignement de notre langue comme une option possible dans ce collège…
Le travail à effectuer dans les camps est énorme, et petite est notre action en regard de ce qu’elle pourrait être. Nous ne sommes heureusement pas les seuls, et d’autres organisations humanitaires s’occupent avec le même cœur de ces malheureux réfugiés.
L’argent arrive fort bien, et régulièrement, à ceux auxquels il est destiné. Nous l’envoyons à nos correspondants sur place. Ce sont en général des prêtres ou des religieuses qui se débrouillent pour le faire entrer dans les camps. Nous tenons à la disposition de nos amis une comptabilité qui rend compte des entrées et des sorties du budget de l’Association. Les délégués locaux nous font parvenir trimestriellement les bordereaux de distribution signés par les bénéficiaires de l’aide. Le seul camp dans lequel nous ne pouvons absolument pas pénétrer est Khao-I-Dang. L’interdiction est en fait une mesure de dissuasion du gouvernement thaï. Les conditions y sont particulièrement dures. Le Haut-Commissariat aux Réfugiés, dont le dévouement est connu, y distribue ce qu’il peut, et surtout ce minimum internationalement établi par des conventions entre États. Inutile de dire qu’il s’agit d’une pratique radicalement insuffisante. Malgré le fait que rien ne peut être introduit, 6 000 clandestins vivent dans ce camp qui compte 35 000 personnes. Ces clandestins, qui sont la meilleure preuve que la dissuasion est inefficace, ne disposent de rien pour subsister. Ils partagent les maigres rations de leurs amis ou connaissances. Il faudrait exercer une véritable pression sur la Thaïlande pour que cesse un état de fait odieux. Épisodiquement, une mesure de clémence intervient et quelques clandestins voient leur situation régularisée, mais dans l’ensemble les fonctionnaires
laissent se perpétuer une espèce de « flou artistique » qui les arrange parce que, en opérant de temps en temps des contrôles éclair, ils peuvent expulser des clandestins gênants ou «arranger» à leur profit des situations illégales. A part les exceptions que je viens d’évoquer, les parrainages n’ont pas trop le droit de visite aux bénéficiaires. Il me semble que le droit de visite aux réfugiés devrait être réglé par les conventions internationales. Aucun gouvernement ne devrait pouvoir s’y opposer. Je comprends sans peine qu’un pays comme la Thaïlande doive suivre un règlement strict pour la mise en place et la gestion des camps. Mais il est inacceptable que sa juridiction soit de nature, en certains lieux, d’interdire la rencontre avec ceux que la misère, la persécution ou la guerre ont conduits contre leur gré à devenir des «internés de longue durée ».